Seynabou Sonko : « C’est nous, les spécialistes des Blancs ! »
Autrice et musicienne, la Franco-Sénégalaise sort un premier roman, « Djinns », et fait le choix de la complexité par rapport aux prises de position identitaires.

L’autrice Seynabou Sonko a grandi dans le 20e arrondissement de Paris, puis elle est partie étudier à Saint-Denis, où elle a découvert Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, Maryse Condé… © Jean-François Paga/éditions Grasset
Djinns, le titre du premier roman de Seynabou Sonko, peut se traduire de l’arabe par « esprit ». Et de l’esprit, il y en a à revendre dans le livre de l’autrice née en 1993. Le vrai sens du mot se trouve dans un extrait : « Selon la sourate 51 du Coran, les djinns, tout comme les hommes, ont été créés par Dieu afin qu’ils l’adorent […]. Bons ou mauvais, ils peuvent prendre la forme de végétaux ou d’animaux, principalement des serpents, allant jusqu’à posséder mentalement ou spirituellement un être humain. »
Djinn et schizophrénie« Djinns », de Seynabou Sonko, est paru aux éditions Grasset. © Éditions Grasset
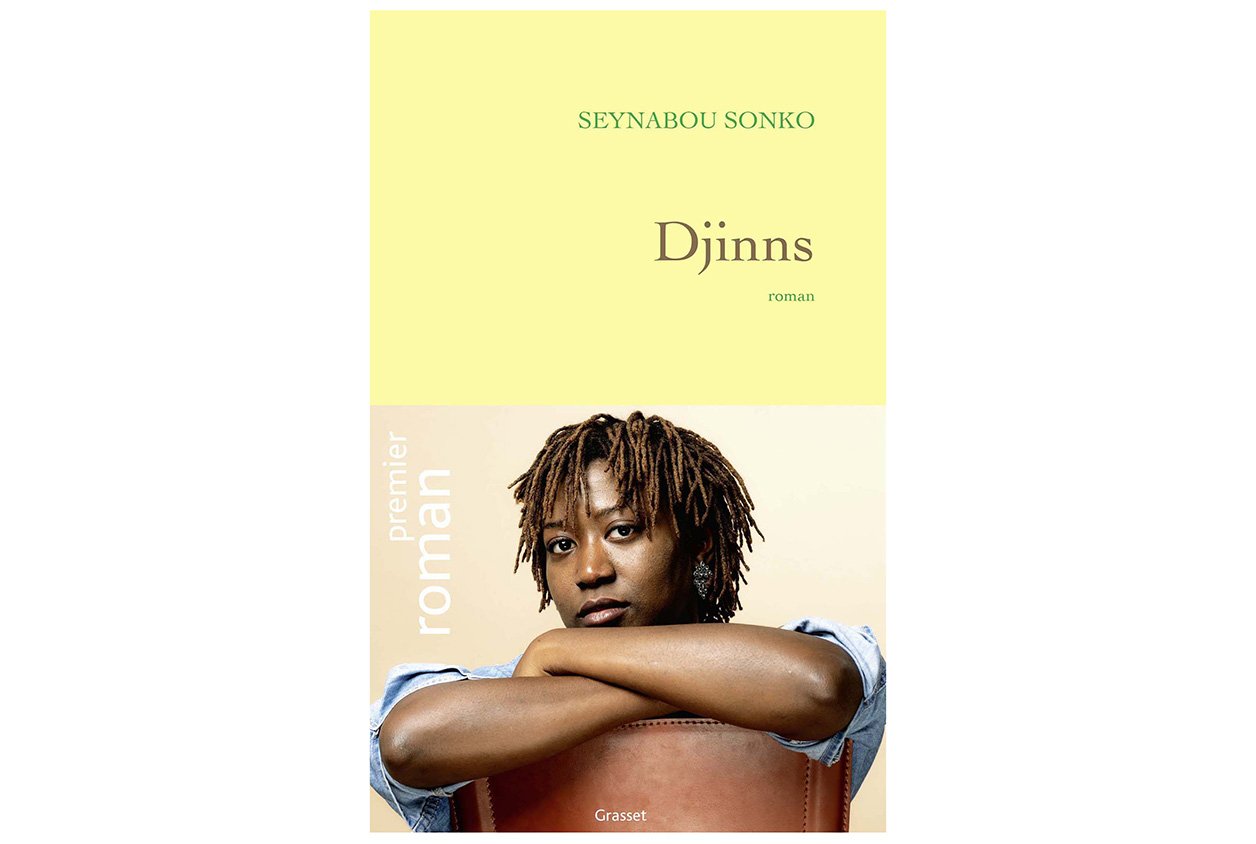
Un djinn est l’élément déclencheur de l’intrigue. Celui de Jimmy, le voisin de Penda – la narratrice –, interné dans un hôpital psychiatrique. Diagnostic médical : schizophrénie. Cela ne convainc pas Mami Pirate, Shango et tout une galerie de personnages hauts en couleurs qui vont échafauder un plan pour le sortir de là.
La particularité du djinn de Penda est qu’il est « blanc, du genre blanc de chez blanc ». Un choix que Seynabou Sonko, rencontrée à Tanger, au Maroc, lors du festival Littératures itinérantes , nous explique : « Dans les romans, un personnage est blanc par défaut. Une des questions que je me suis posée est : comment laisser transparaître que le personnage est noir sans le dire ? Est-ce que ça passe par utiliser des mots en wolof ou en bambara ? Est-ce qu’il faut que j’écrive une scène où je décris ses cheveux pour que l’on comprenne qu’elle a une coupe afro ? Puis j’ai décidé qu’il serait plus simple d’affirmer que l’autre était blanc. »
Ce djinn est un marqueur de couleur, mais pas seulement : « C’est symbolique, je m’en sers pour parler du racisme en France. Ce sont des intuitions. Dans la vie de tous les jours, je ne les rationalise pas, ou on ne m’écoute pas, parce que cela part d’un ressenti. J’ai voulu le transformer en quelque chose d’indiscutable, de telle façon qu’on ne puisse pas renvoyer l’expérience à de la paranoïa. »
Dans une comparaison avec la boxe, Seynabou Sonko, qui pratique elle-même le noble art, écrit qu’oublier qu’on est une femme noire, c’est comme baisser sa garde : « Je devrais être habituée aux remarques racistes mais, chaque fois, je suis surprise. Je n’arrive pas à comprendre comment on peut être aussi stupide. Ce qui m’anime dans l’écriture, c’est de me mettre à la place de l’autre, qu’il soit dominant ou dominé. » Ce qui la conduit à un constat désabusé qu’elle dresse avec humour : « Des racistes, j’en ai tellement vu… J’ai de l’empathie pour eux. Je connais presque mieux qu’eux leurs mécanismes. C’est nous, les spécialistes des Blancs, tellement ils nous violentent. On sait comment ils pensent. »
Médicaments ou racine d’iboga ?
Pour guérir Jimmy, deux méthodes s’opposent. L’une traditionnelle, à l’aide de la racine d’iboga proposée par Mami Pirate. L’autre, la psychiatrie et ses médicaments chimiques : « J’avais envie de montrer que les deux ne sont pas à égalité. La psy regarde Mami Pirate de haut. » Au-delà de la pratique médicale, ce clivage illustre l’entre-deux dans lequel navigue Penda, à l’origine d’un sentiment d’étrangeté qui la poursuit en France mais aussi dans son pays d’origine, qu’elle visite à l’âge de 12 ans : « C’est simple, quand t’es Sénégalaise, si t’es pas coiffée, pas mariée, t’es soit droguée, soit artiste. Aucune Sénégalaise digne de ce nom ne se rase les cheveux. »
Ce voyage a une portée initiatique pour le personnage : « Cette fois j’avais compris, rien n’était plus fatigant que de devoir justifier son existence, que ce soit d’un côté ou de l’autre de la Méditerranée. Mon ambition était ailleurs, dans un lieu où les choses auraient plus d’importance que les êtres, où l’invisible servirait à imaginer un nouveau monde, digne d’être rendu visible. » Des propos qu’appuie Seynabou Sonko : « L’idée, peut-être utopiste, est de briser les frontières. En France, ce qui est attendu, c’est de prendre position sur les questions identitaires, là où je fais le choix de la complexité, des nuances, d’une certaine forme de spiritualité. Iboga, c’est aussi une façon de se laver l’âme du ressentiment. »
Autobiographie ? Non merci
La question de la portée autobiographique du premier roman se pose inévitablement, mais Seynabou Sonko s’en défend : « Penda, ce n’est pas moi. Elle m’emprunte certains aspects dans sa manière de regarder les autres personnages, de décrire son entourage plutôt que de parler d’elle-même, d’apprendre à se connaître en évoquant autrui. Mais la fiction me permet d’avoir une audace que je n’aurais pas dans la vie, et de sortir d’un déterminisme social, politique. Je peux créer un espace de liberté. »
Le goût des mots, Seynabou Sonko le cultive dans Djinns, son premier roman, mais aussi à travers la musique, sous le nom de scène de Naboo : « J’ai commencé a écrire des chansons en même temps que je me suis mise à écrire, vers l’âge de 13 ans. » Ses influences musicales lui viennent de ses sœurs aînées, qui « écoutaient du zouk, du RnB, du rap américain sur MTV puis qui regardaient, plus tard, la Star Academy ». En même temps, elle lit des romans au Centre de documentation et d’information (CDI) de son établissement scolaire, où elle découvre la trilogie Twilight, de Stephenie Meyer. Et elle suit des chemins de traverse grâce à une rencontre : « Un surveillant du collège a commencé à me prêter des livres pour adultes, comme Le Postier, de Charles Bukowski, Septentrion, de Louis Calaferte, King Kong Théorie, de Virginie Despentes. Plein de livres sulfureux. J’avais l’impression que c’était interdit. Bukowski, c’est trash, et bien qu’on n’ait rien en commun, j’ai pris une grosse claque. »
Ce goût des lettres l’oriente dans le choix de ses études supérieures. Comme à son habitude, elle va là où on ne l’attend pas : « J’ai grandi dans le 20e arrondissement de Paris, j’ai suivi toute ma scolarité, jusqu’au lycée, dans la capitale. J’ai décidé d’aller à Saint-Denis, pour rencontrer des gens qui me ressemblent, alors que toutes mes copines voulaient étudier à La Sorbonne. »
Un cursus en banlieue qui ouvre son horizon : « J’ai alors découvert Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, Sony Labou Tansi, Maryse Condé… Alors que j’avais passé la majorité de mon adolescence à lire des auteurs blancs. Je réalise qu’il y a des gens qui écrivent et qui me ressemblent. » Et pourtant, elle se retrouve à contre-courant au moment de passer en master : « Mes amies banlieusardes n’avaient qu’un but en tête, poursuivre leurs études à Paris. Elles sont parties, principalement à la Sorbonne Nouvelle. »
Entre rap et littérature
Aujourd’hui, Seynabou Sonko se projette à la fois dans son deuxième roman et dans une production musicale. Ses influences, on les décèle dans son opus, qui s’ouvre sur des paroles de PNL, et emprunte à Kekra le titre du chapitre « Vréel ». Elle aime « leur manière d’utiliser la langue avec une grande liberté ». Les rappeurs l’inspirent, car écouter du rap lui permet de « travailler sa technique ». Elle précise aussitôt : « Mais je ne rappe pas du tout, j’ai de la voix, cette capacité à aller dans les graves et les aigus. En ce moment, je compose avec un beatmaker et j’ai trouvé la manière de faire de la musique qui me correspond le mieux. Ça ressemble à du RnB futuriste. » Elle conclut sur une phrase qu’aurait pu prononcer Penda pour décrire son rapport au monde : « Musicalement, j’ai l’impression d’être double. » Et c’est tant mieux, car le plaisir de lire et d’écouter cette autrice de grand talent est ainsi décuplé.


