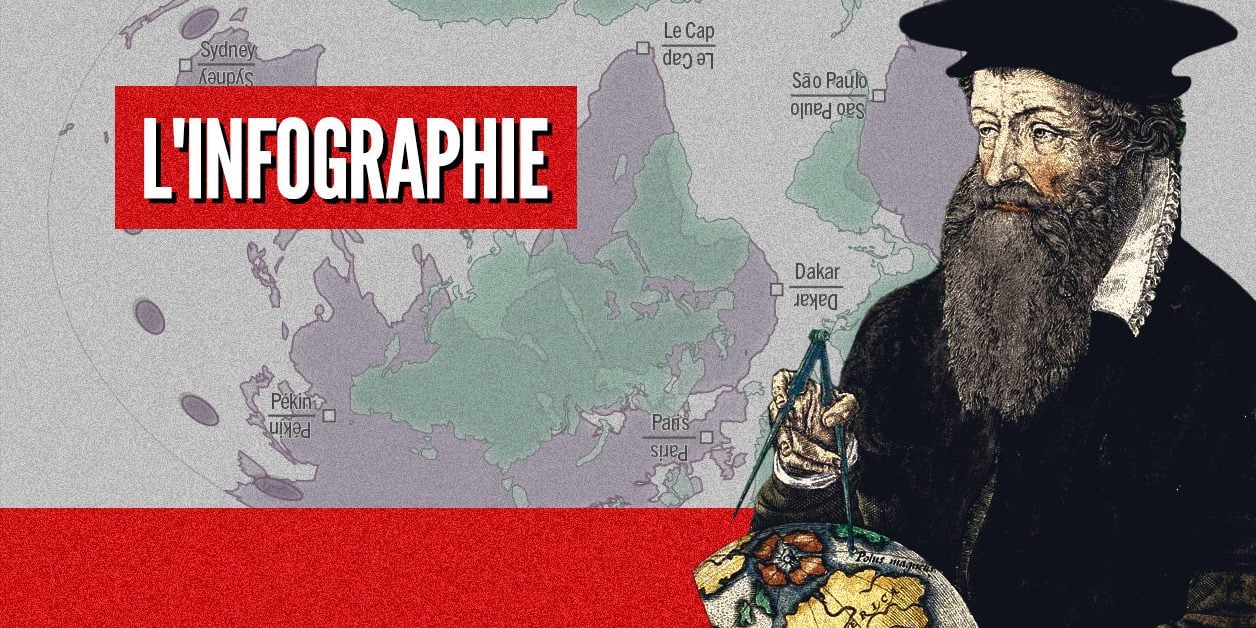Lefaso.net : Que vous rappelle cette nuit du 3 au 4 août 1983 ?
Alban Zagré : C’est une date historique, qui rappelle beaucoup de souvenirs, en ce sens que le quarteron qui est arrivé dans la nuit du 3 au 4 août 1983 à 21h, personne ne s’y attendait. On se préparait pour célébrer la fête de l’indépendance du pays, le 5 août, et à la surprise générale, voilà que de jeunes capitaines arrivent et renversent le régime du médecin-commandant Jean-Baptiste Ouédraogo qui était au pouvoir depuis le coup d’Etat de 7 novembre 1982. Le lendemain, le peuple burkinabè a commencé à descendre dans la rue par manifester son soutien à ces jeunes militaires-là.
A l’époque, nous étions très jeunes, mais on sentait déjà en nous, une motivation. A l’école, on nous avait mobilisés et jusqu’à ce qu’en mai 1985, le Mouvement national pionnier soit officiellement créé parce que, lorsque la Révolution est arrivée, on a commencé à mobiliser tout le monde, surtout les jeunes ; tout le monde devait adhérer au mouvement de la Révolution et apporter sa petite contribution pour qu’ensemble, nous puissions bâtir notre pays. Et tout de suite, nous y avons adhéré. Nous sommes restés pionniers jusqu’à la chute de la Révolution, le 15 octobre 1987.
Mais il faut dire qu’entre temps, les révolutionnaires ont installé dans les permanences, ce qu’on appelle le Comité de suivi des pionniers. Et tous les soirs, les pionniers venaient pour faire des mouvements ; comme si nous étions des militaires, on nous apprenait le ‘’garde-à-vous’’, le demi-tour à gauche, à droite, etc. On nous apprenait tout. Les chefs historiques de la Révolution, à savoir Thomas Sankara, Blaise Compaoré, Jean-Baptiste Lingani ou Henri Zongo, nous surprenaient parfois, individuellement, à la permanence. Comme on ne savait pas à quel moment on pouvait recevoir leur visite inopinée, on était tout temps là ; parce que des fois ils venaient même à 2h du matin, pour voir si on ne dormait pas, surtout pendant les vacances, tous les jours on était-là.
Le « Pionnier », qui était-il ?
C’est le plus jeune militant formé par la Révolution. Les pionniers étaient donc des groupes de jeunes (quatorze, quinze, seize ans …) formés pour porter les idéaux de la Révolution. La mission des pionniers était de valoriser donc l’image du pays, tant sur le plan national qu’international. Et sa devise, c’est « oser lutter, savoir vaincre, vivre en révolutionnaire, mourir en révolutionnaire, les armes à la main ! La patrie ou la mort, nous vaincrons ! ».
C’est vrai, beaucoup de parents étaient réticents, mais nous avons bravé des obstacles pour nous présenter dans le mouvement national Pionnier et au final, les parents ont estimé que ce n’est pas la peine d’empêcher les enfants ; c’est la fougue d’une jeunesse au pouvoir, qui veut mobiliser les jeunes et leur apprendre les rudiments de la Révolution. Certains parents ont donc encouragé les enfants à continuer et c’est ainsi que nous y sommes restés, jusqu’à la chute de la Révolution.
Dans le mouvement des pionniers, beaucoup ont eu la chance d’aller en Libye et à Cuba pour étudier. Moi, même si j’avais eu cette chance, mon père n’allait pas accepter (ndlr : il explique qu’étant le fils d’un ancien chef d’Etat-major général des forces armées voltaïques, à l’époque, il ne pouvait pas avoir cette autorisation pour aller en Libye ou à Cuba). Mais des camarades sont allés et sont revenus nous faire le point, surtout ceux qui sont allés en Libye (parce que ceux qui partaient à Cuba, c’était pour étudier et se faire former dans certains domaines, contrairement à ceux qui sont partis en Libye, où ils y sont restés en visite presqu’un mois et sont revenus).
De ce mouvement national Pionnier, je retiens donc beaucoup de choses. Face au fait accompli, le 15 octobre 1987, nous avions cru que Blaise Compaoré allait continuer sur la même lancée, la Révolution. Mais hélas ! Hélas ! Hélas ! Blaise Compaoré a fait semblant. Quand on pose la question aux « Sofas » ; les Sofas sont les encadreurs des pionniers, eux aussi nous disaient qu’ils ne savent pourquoi, mais que s’il y a des instructions, ils vont nous faire appel.
C’est comme cela que petit-à-petit, le mouvement national Pionnier est mort. Que voulez-vous ? C’est un nouveau régime qui est là ; la Révolution n’existe plus, Blaise Compaoré a fait semblant, uniquement pour plaire à l’Occident. C’est comme cela, ce sont des péripéties qui arrivent dans la vie, il faut les accepter. Nous (pionniers, colombes, petits chanteurs au poing levé) avons pleuré, quand on a appris que le président Sankara a été assassiné.

Pensez-vous que le mouvement national Pionnier aurait pu se poursuivre ?
Si le mouvement avait existé jusqu’à aujourd’hui, c’est sûr que le Burkina allait être un véritable havre. Ça, il ne faut pas se le cacher. A l’époque de la Révolution, nous étions présents à toutes les manifestations. Quelle que soit la manifestation, Thomas (Sankara) a exigé que les pionniers soient toujours présents pour l’exécution de l’hymne national. Et j’ai eu la chance, très jeune, de serrer la main de Thomas Sankara, quand il était Premier ministre (parce qu’il logeait dans notre secteur, villa 188, à quelques encablures du stade municipal Joseph Conombo) et encore quand il était président.
Tout cela, grâce au mouvement national Pionnier. Thomas Sankara exigeait que les pionniers viennent assurer sa sécurité, et moi, sur ce même Conseil (l’interview a eu lieu au mémorial Thomas Sankara, ndlr), en 1986, j’ai été sélectionné dans mon secteur, pour venir ici assurer sa sécurité une nuit. C’est pour vous dire à quel point, Thomas (Sankara) incarnait les slogans qu’il véhiculait. Il a toujours dit dans ses discours : « Le pouvoir appartient au peuple, c’est le peuple burkinabè qui décide. Pas un pas sans le peuple. De l’eau potable pour tous et non du champagne pour quelques-uns ».
Voilà pourquoi, il a toujours dit également que la révolution est victoire, l’échec appartient à la réaction et à la contre-révolution. Il dit que si nous ne nous battons pas, si nous ne posons pas les jalons, si nous n’inculquons pas ça dans les mentalités de nos enfants à l’école, demain, ça va être difficile. Donc, si le mouvement existait toujours, tout ce qui avait été posé comme jalons allait se poursuivre. A l’époque, il fallait nous voir : culotte et kaki fourrés, souliers, chaussures basses, béret incliné à 90°, avec un foulard accroché autour du cou. Et Thomas nous avait donné l’autorisation de nous habiller en pionniers dans les classes.
Donc, si le président Sankara était toujours vivant et que le mouvement pionnier était en activité jusqu’à ce jour, ça n’aurait pas été un gâchis ; au contraire, ça aurait été un plus qui allait permettre à la génération actuelle de comprendre véritablement, le pourquoi de la Révolution d’août 1983. Quand tu regardes cette jeunesse, qu’est-ce qu’elle sait ? Cette jeunesse-là ne sait absolument rien. C’est dommage et triste. La Révolution fait partie de l’histoire de notre pays, mais ce n’est pas enseigné dans nos écoles.
Ça vous fait de la peine de voir les jeunes dans des états d’esprit opposés aux valeurs que la Révolution voulait imprimer à la société burkinabè ?
Ah oui, ça fait très mal. Une petite anecdote. J’ai échangé avec des élèves du Lycée Marien Ngouabi, Lycée Dimdolobsom, du Lycée John Kennedy. A chacune des instances, j’ai toujours posé une seule et même question : connaissez-vous l’histoire de l’homme dont votre établissement porte le nom ? On m’a toujours répond « non ». C’est vraiment dommage. Cet état d’esprit est symptomatique de la jeunesse d’aujourd’hui. Je suis obligé de leur faire comprendre que Marien Ngouabi, c’était ce révolutionnaire, née en décembre 1939 et arrivé au pouvoir à peine 30 ans (en 1969). Et là-bas aussi (dans son pays, Congo-Brazzaville), c’était la Révolution : la patrie ou la mort, nous vaincrons ! ; les CDR, le CNR (Conseil national de la Révolution), etc.
Nous avons calqué le modèle béninois et le modèle congolais. A l’époque, Marien Ngouabi était le seul chef d’Etat au monde qui circulait en 504 (voiture modeste, ndlr) et aussi le seul chef d’Etat qui s’est s’inscrit à l’université (publique) pour préparer un diplôme en physique. Il se rendait à l’université, comme tout bon étudiant, il rentre dans l’amphi et suit les cours. Jusqu’à ce que l’impérialisme l’assassine un vendredi de 18 mars 1977, en début d’après-midi au palais présidentiel, alors qu’il était à table en train de dîner avec son épouse et deux de ses enfants. Il a été abattu par un ancien membre de sa garde présidentielle, un adjudant.
Le Lycée Dimdolobsom, pareil, ils ne connaissent pas. Alors qu’en un mot, Dimdolobsom, à l’état civil, André Augustin Dimdolobsom Ouédraogo, originaire de Sao, sur la route de Ouahigouya (route nationale N°2, ndlr), est né en 1897 et décédé en juillet 1940 tandis que John Kennedy, 35è président des Etats-Unis, née le 29 mai 1917 à Brookline, près de Boston, était un lieutenant de l’armée américaine au cours de la seconde guerre mondiale, qui deviendra président, assassiné le vendredi 22 novembre 1963 à Dallas dans l’Etat de Texas par un ancien marine. Mais, dites-moi, lorsque des élèves ne cherchent même pas à comprendre l’identité des hommes dont leur établissement porte le nom, comment peut-on qualifier un tel état d’esprit ?
J’ai demandé à ces élèves, si ailleurs, il y a des Lycées Thomas Sankara, et qu’ils apprennent que les élèves qui y fréquentent ne connaissent pas l’histoire de Thomas Sankara, est-ce que ça va leur plaire ?
Même si on ne vous enseigne pas, cherchez à connaître, c’est quand même un b.a.-ba ! Aujourd’hui, les élèves, les étudiants, la jeunesse ont tout à leur portée. Tout ! On ne peut pas tout apprendre à l’école, il faut compléter par des recherches. Moi qui vous parle, j’ai eu à discuter avec une volontaire américaine qui était-là, sur l’histoire des Etats-Unis, mais elle était complètement abasourdie. Je lui dis qu’elle ne peut pas m’enseigner l’histoire des Etats-Unis, mais que ce n’est pas sûr qu’elle connaisse l’histoire de mon pays. Je l’ai entretenue pendant plus d’une heure, elle était assise et ne pouvait plus rien dire. On ne m’a pas appris cela à l’école, c’est dans la lecture, dans mes recherches. C’est ce que la Révolution, avec à sa tête Thomas, nous a appris aussi, la culture générale, l’effort personnel. Avez-vous vu le niveau de culture et de langue de Thomas (Sankara) ? C’est cela…, pour mieux avancer dans ce monde, il faut avoir un certain niveau de culture, connaître sa propre culture et connaître celles des autres.
C’est dommage donc qu’aujourd’hui, les élèves, les étudiants, la jeunesse, ne lisent plus. Et dès lors, comment cette jeunesse peut-elle connaître l’histoire de la Révolution du Burkina ? Pourtant, que les gens veuillent ou pas, même dans 100 ans, on va toujours continuer à parler de la Révolution. Il faut que les générations qui vont venir puissent retrouver les traces du 4 août 1983, parce que ce sont des gens qui ont risqué leur vie (les quatre leaders) ; ça pouvait échouer et, le cas échéant, c’est plutôt leur communiqué nécrologique on allait diffuser.

L’issue violente du 15 octobre 1987 n’est-elle pas pour quelque chose dans la posture de la jeunesse vis-à-vis de cette page importante de l’histoire du pays, la Révolution ?
Effectivement, vous avez raison, ça a contribué ; parce qu’après le coup d’Etat, beaucoup de manuels ont été saisis dans les établissements et à l’université et brûlés par le nouveau régime : les documents de Karl Marx, Engels, Lénine, etc. Pourquoi ? Parce qu’il ne voudrait pas que cette génération s’imprègne de la Révolution. Ça a été une très grosse erreur de ceux-là même qui ont assassiné Thomas Sankara. Il fallait laisser continuer parce que les auteurs que j’ai cités étaient de grands révolutionnaires.
Votre génération a en commun des valeurs de la Révolution, ce qui ne semble pas le cas aujourd’hui, où la jeunesse manque de repères ... !
Je constate effectivement, avec un véritable pincement au cœur. Cette société que vous voyez-là, je vous repose la question, vous, journaliste : elle va où ? La société actuelle n’a pas un repère. Sous la Révolution, si tu n’es pas à l’école, tu es au terrain, dans un atelier, au champ en train de cultiver, etc. Il n’y avait pas un ministère qui n’avait pas un champ. On n’avait pas le temps pour s’asseoir dans les kiosques pour boire des frelatés, déambuler dans les maquis et débits de boisson, etc. Pire, les jeunes d’aujourd’hui sont des individus qui ne veulent même pas qu’on les conseille. Si tu tentes de donner un conseil, tu deviens un ennemi. Où va la société ? On a affaire à une société moribonde, sans repère, qui ne sait même pas où elle va, à plus forte raison où elle atterrira.
Regardez le niveau de nos élèves et étudiants aujourd’hui, c’est décevant ! Et moi j’ai toujours dit aux jeunes, ce n’est pas la peine de nous parler de vos diplômes : BAC plus tant, université pour tel nombre d’années, etc. Mais en réalité, ça ne vole pas haut. Moi, quand je dis aux gens que je n’ai pas le BEPC, certains se fâchent, ils croient que je me fous d’eux. J’ai le niveau d’un élève de la classe de 3e, mais je n’ai pas le diplôme équivalent, pour avoir refusé en 1989 de passer le BEPC. Je n’ai que le CEPE, que j’ai obtenu en juillet 1985 à l’école centre A à Koudougou (province du Boulkiemdé).
C’est tout ce que j’ai comme diplôme. C’est pour dire qu’il faut se former dans la vie. Je suis un mordu de la lecture. Quand vous arrivez chez moi, vous verrez la hauteur impressionnante de mes journaux, jusqu’au plafond. De par mon regretté père, qui fut depuis 1956 à Dakar, abonné de ‘’Afrique Action’’, devenue plus tard ‘’Jeune Afrique’’ (en octobre 1960), j’ai gardé beaucoup de parutions. Même quand il est rentré au pays, il a continué à recevoir le journal ; c’est moi qui partais à côté, à l’hôtel indépendance tous les mercredis pour récupérer le journal. Et dès qu’il finissait de lire, il me le passait.
J’ai donc des journaux de …, 1978, 1980, 1990, etc. J’ai par exemple des journaux comme « Le Regard » de Patrick G. Ilboudo ; « L’Intrus », « Lolo wilé », des journaux qui ont paru sous la Révolution. Il m’arrive de descendre quelques journaux pour relire pour me rafraîchir la mémoire. J’évoque tout cela pour dire qu’on ne peut pas se limiter seulement à son niveau à l’école, il faut aller au-delà en s’auto-formant. Il faut apprendre à connaître son pays.
Date de création, de suppression et reconstitution de notre pays, les acteurs, etc. Quelle honte de ne pas connaître cela ! Les peuples et les pays que nous envions aujourd’hui se sont pris au sérieux. Le petit Américain connaît l’histoire du 4 juillet. Le petit Français connaît l’histoire du 14 juillet. Mais ici, c’est l’éternel tâtonnement. Les gens ne connaissent même pas le symbole de la République. Quelle catastrophe ! Qui sont les acteurs qui ont lutté pour que notre pays soit reconstitué à la date du 4 septembre 1947 ? Si on ne connaît pas notre histoire, on se défend comment ?
Nous pouvons commencer par remercier des devanciers comme le Mogho Naaba Kom II, qui est décédé en 1942 ; celui-là même qui s’est déplacé à Bingerville, en Côte d’Ivoire, pour rencontrer le gouverneur. Son fils, Saaga II, a pris le relais, il a continué la lutte, et le 4 septembre 1947, la loi reconstitue la Haute-Volta dans ses limites de 1932. Ce fut l’euphorie générale ! Saaga II meurt en novembre 1956, remplacé par son fils, Moag Zoug Soaba Kougri.
On a créé la colonie de Haute-Volta, le 4 mars 1919, avec comme premier gouverneur Frédéric Charles François Edouard Heisling (de 1919 à 1927, il est décédé en 1932 en France), supprimée treize ans plus tard, pour des raisons économiques, puis reconstituer le 4 septembre 1947. Lorsque le Blanc a fait venir le train à Bobo-Dioulasso, il a dit clairement que le train-là ne va jamais entrer à Ouagadougou parce qu’à Ouagadougou, il n’y a rien.
C’est le même Saaga II, qui a œuvré et le train a sifflé ici à Ouagadougou, en novembre 1957, une année après qu’il soit décédé. Ça fait partie de l’histoire de notre pays. Puis l’étape de l’indépendance de notre pays. N’eût été son décès le 7 septembre 1958 à l’hôpital Saint-Antoine à Paris, c’est celui-là même qu’on a qualifié à l’époque de « lion du RDA », Daniel Ouezzin Coulibaly, qui allait proclamer l’indépendance de la Haute-Volta, aujourd’hui Burkina Faso. Maurice Yaméogo était ministre dans le gouvernement colonial. Lorsque Daniel Ouezzin Coulibaly est décédé, il a été propulsé. C’est ainsi qu’il a eu la chance de conduire notre pays à son indépendance, le 5 août 1960, en ces termes que vous connaissez : « Aujourd’hui, 5 août 1960, à zéro heure, au nom de droit naturel de l’homme à la liberté, à l’égalité et à la fraternité, je proclame solennellement l’indépendance de la République de la Haute Volta ».
C’est la phrase que tout le monde connaît, alors qu’il y a une suite : « Neuf siècles d’histoire ont révélé au monde, la valeur morale de l’homme voltaïque. C’est à partir de cette valeur que nous voulons bâtir notre nation. J’exprime ma plus profonde reconnaissance à tous les artisans de notre indépendance nationale. Vive la République de la Haute-Volta indépendante à jamais ! ». Et le 20 septembre 1960, la Haute-Volta est admise comme membre à part entière de l’Organisation des nations unies. Il faut que la jeunesse arrête les bêtises et apprenne ce qui est utile, à commencer par sa propre histoire. Aujourd’hui, quand tu veux parler de choses sérieuses avec un jeune, tu deviens son ennemi ou il pense que tu es dépassé.
L’hôpital Yalgado Ouédraogo ?
A l’état civil, Ibrahim Yalgado Ouédraogo, né en juillet 1925. Il soignait beaucoup de maladies. Tout comme Daniel Ouezzin Coulibaly, née en 1909, il fut instituteur, directeur d’école à Banfora avant d’occuper les fonctions de surveillant général à l’Ecole William-Ponty de Dakar (1934-1936), premier chef de gouvernement de la Haute-Volta, sous le régime de la loi-cadre de 1956. Il est mort en septembre 1958 à Paris à 52 ans. Il faut que la jeunesse arrête de dire qu’on ne lui apprend rien. C’est tout cela qui fait notre pays, sa cohésion sociale, et qui a permis de recouvrer l’intégralité de son territoire.
Aboubacar Sangoulé Lamizana et Baba Sy furent les deux plus gradés qui ont quitté l’armée française avec le grade de capitaine. Au départ, ils étaient treize officiers (deux capitaines, trois lieutenants et le reste était des sous-lieutenants). Donc, après Aboubacar Sangoulé Lamizana, c’est Baba Sy, et après lui, c’est le lieutenant Bila Zagré, puis le lieutenant Tiémoko Marc Garango, Belmoko Dah (le reste était des sous-lieutenants). Ce sont ces mêmes qui, après l’indépendance de notre pays, sont allés s’entretenir avec le président Maurice Yaméogo pour lui dire clairement de ne pas accepter que la France installe une base militaire sur le sol voltaïque.
Que par contre, ce qu’il pouvait accepter, c’est de signer des accords de coopération et d’assistance militaire avec la France. Mais jamais de base militaire. De Gaulle (Charles De Gaulle) avait usé de tout son poids pour dire à Félix Houphouët-Boigny de mettre la pression sur Maurice Yaméogo pour qu’il accepte que la France installe une base militaire sur le sol voltaïque. Mais à la surprise générale, et devant De Gaulle, Maurice Yaméogo a dit non. Il y a eu à cet effet trois rencontres : en juin, juillet et octobre.
A la troisième rencontre, Maurice Yaméogo a tapé le poing sur la table pour dire que 31 décembre 1960, départ de l’armée française du sol voltaïque. C’est ainsi que Houphouët-Boigny a dit à De Gaulle que pas de base militaire française sur le sol voltaïque. J’ai aussi beaucoup appris auprès de mon regretté père, parce que j’ai été son chauffeur pendant 23 ans. J’en sais donc beaucoup, sur la création de l’armée voltaïque, le 1er novembre 1960.
Donc, il faut que la jeunesse apprenne, parce qu’on ne peut pas mener une lutte utile tant qu’on ne connaît pas son histoire, tant qu’on n’a pas la culture de soi et des autres. On dit la jeunesse est le fer de lance, mais c’est de quel type de jeunesse on parle ? Actuellement, on assiste à un réveil par la lutte contre l’impérialisme, c’est bien. Mais, comment gérer la suite ? C’est là toute la difficulté. Et dans la gestion, il faut inclure sa propre formation (formation des jeunes eux-mêmes, ndlr). Si vous ne vous formez pas, vous terrassez l’impérialisme, mais vous allez toujours piétiner. Et pour combattre un phénomène, il faut d’abord apprendre à le connaître. La génération de Thomas Sankara a beaucoup lu, elle l’a prouvé.

Que retenez-vous le plus de la Révolution ?
C’est l’auto-suffisance alimentaire. La Révolution a tout fait pour que dans chaque famille, on prépare ne serait-ce qu’un repas par jour. Thomas a multiplié le rendement à l’hectare : de 1 600 kg à 3 900 kg de céréales (mil). C’est tout cela qui a permis aux Burkinabè d’avoir ne serait-ce qu’un repas par jour. Les trois luttes (contre la coupe abusive du bois, la divagation des animaux et les feux de brousse) ont payé. Plus de 20 millions de plants mis en terre, durant la Révolution. C’était une vision, l’intérêt général, le sens du sacrifice pour le pays, pour le peuple. Aujourd’hui, vous avez plutôt une corruption qui est galopante. C’est la gabegie totale. Triste ! (Il marque un silence d’émotion, secoue et baisse la tête, ndlr).
Je me surprends en train d’échanger avec vous, vous êtes vraiment chanceux, car en réalité, je n’aime pas m’exprimer ; j’ai été plusieurs fois contacté pour des interviews à la télé et pour des émissions-radio, mais j’ai toujours décliné.
Pour moi, la Révolution était plus que nécessaire ; il fallait qu’elle vienne. Nous étions quoi avant la Révolution ? Nous n’étions ‘’rien’’ ! Je le répète, c’est grâce à Thomas Sankara qu’on a pu situer le Burkina sur une carte. Il s’est exprimé à la tribune de l’ONU, le 4 octobre 1984. Avant cela, le 3 octobre, il est parti à Harlem, le quartier des Noirs, à New-York, où il a tenu un discours, et où tout le monde se posait la question de savoir c’est qui ce jeune capitaine ?
Aux USA, on avait d’abord refusé de lui donner un visa, pour finalement le lui accorder et dire de ne pas aller à Harlem. Thomas Sankara dit qu’il n’est pas question, il ira. Et il y est allé. Voyez-vous, il faut que cette jeunesse s’inspire de son histoire et cherche ses propres repères, arrête de courir derrière les solutions de facilité et le gain facile. Ça ne mène nulle part, c’est flatteur. Les jeunes d’aujourd’hui s’amusent trop : alcool, vie de luxe, sexes, … C’est triste !
En plus, on ne travaille pas. Un pays comme le Burkina, prenez le calendrier, nous avons combien de jours chômés payés dans l’année ? Avec ça, on veut compétir avec les autres nations ? Quand même, soyons sérieux ! Il faut d’abord se mettre au travail ! Si on ne veut pas se mettre au travail et encore pour un rien, chômé payé, pendant ce temps, les autres avancent, il ne faut pas crier sur tous les toits que le problème, c’est l’autre. C’est trop facile et même lâche. Et j’aime poser cette question, surtout aux jeunes : « Etes-vous fiers d’être Burkinabè ? ». Quand on est fier d’être Burkinabè, on travaille dur, et partout où on passe, on est intègre, on défend les valeurs d’intégrité.
Combien savent que la fête du 1er mai est née aux USA ? Il y a eu d’abord le 8 mars, en 1857, et 29 ans plus tard, la naissance de la fête du travail (1er mai 1886), lorsque des ouvriers sont descendus sur l’avenue Michigan, à Washington, pour réclamer l’instauration de la journée de huit heures de travail et qui ont été massacrés. Et combien savent que le 1er mai est chômé dans plusieurs pays dans le monde, y compris au Burkina Faso, sauf les USA ? Sommes-nous plus légitimes pour fêter le 1er mai que les USA ?
Il est donc temps que chacun ait son repère, et nous au Burkina Faso, notre repère, c’est la Révolution. Nous avons engagé et remporté des batailles avec les chefs historiques de la Révolution, et nous sommes fiers de l’œuvre qui a été accompli, même si malheureusement, elle s’est terminée dans le sang et qu’il n’y a pas eu de suite. La Révolution a duré le temps d’un feu de paille : 4 ans, 2 mois et 11 jours. Mais son bilan est plus que positif. Il fallait qu’elle arrive. Chacun est libre de faire son bilan, et le mien, c’est que la Révolution a été plus que positive.
Interview réalisée par Oumar L. Ouédraogo
Lefaso.net