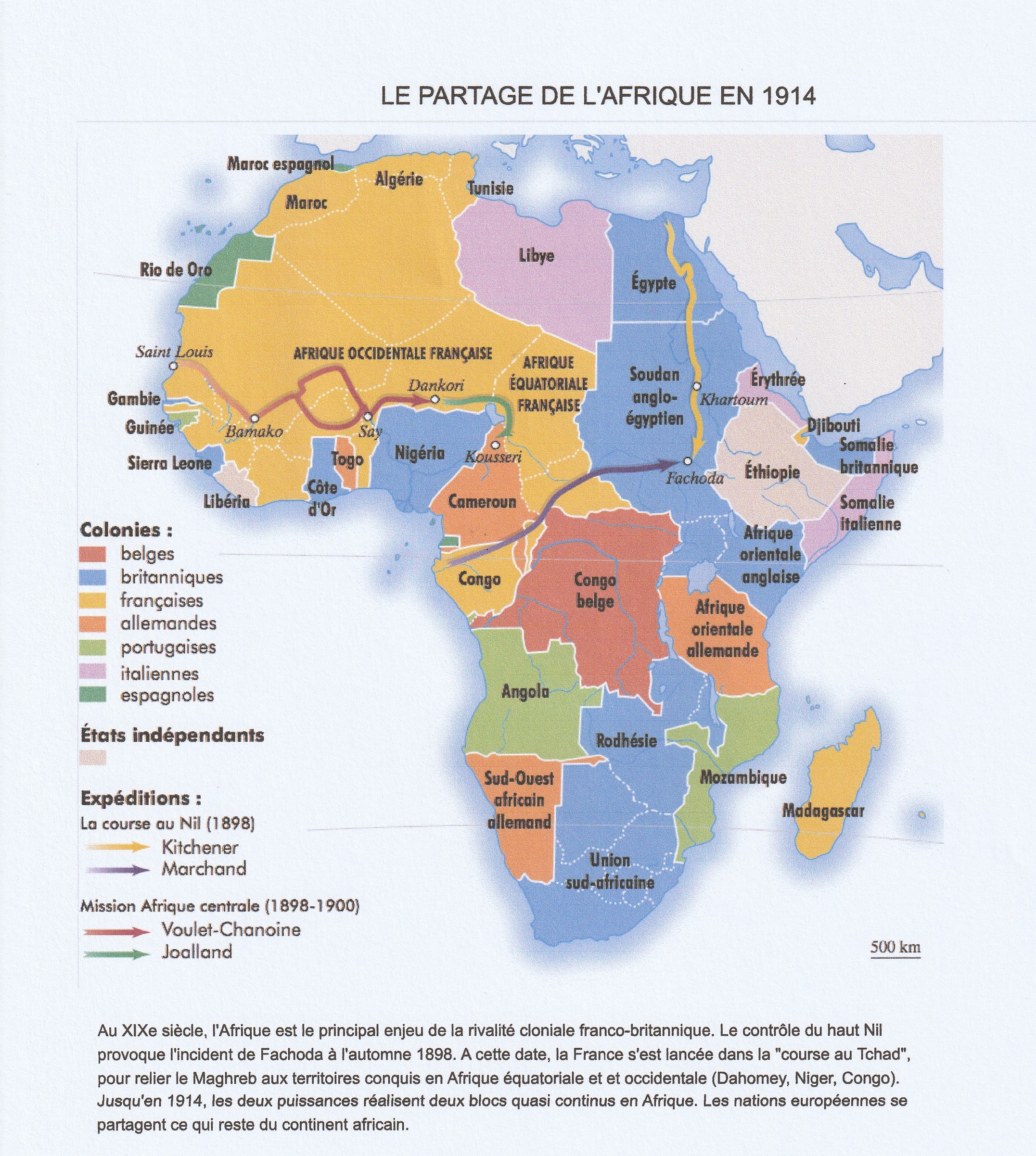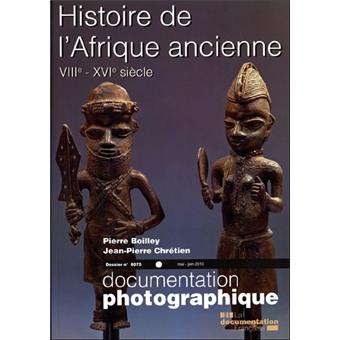L’Unesco, qui célèbre chaque 9 juin la Journée internationale des archives, vient d’inscrire dans son registre Mémoire du monde celles du Centre Joseph-Wresinski d’ATD Quart Monde. Depuis sa création en 1957, cette association consigne les traces du vécu de la grande pauvreté dans 32 pays.
« Madame, si j’ai accepté de vous recevoir, c’est parce que je me suis promis qu’aussi loin que je pourrai aller, je ferai entendre la parole des plus démunis », nous dit Gérard Lecointe, 74 ans. Il a fait ce serment il y a de nombreuses années déjà, en allant toucher de la main la dalle posée en 1987 place du Trocadéro à Paris en l’honneur des victimes de la misère par le père Joseph Wresinski, fondateur d’ATD Quart Monde.
Il a beaucoup à dire sur la grande pauvreté, Gérard. Enfant, il a grandi dans des baraquements que les voisins appelaient la cour des miracles. À l’école, on l’installait au fond de la classe avec les gamins qui ont toujours des lentes. À 10 ans, il a été placé, sans qu’on lui dise pourquoi. Puis, à sa majorité, il a été renvoyé chez ses parents. Il est alors allé vivre dans la forêt. « Vous savez, j’ai dû voler pour manger et pour m’habiller. Et quand on n’a nulle part pour se laver, on perd toute sa dignité », résume-t-il.
Cette page est tournée désormais. Aujourd’hui, Gérard a une santé fragile – il est sous oxygène et se déplace en fauteuil roulant – mais il a un toit au-dessus de la tête. Surtout, il a maintenant les mots pour raconter son histoire, dont il a fait un livre en 2009. Depuis sa vie dans la forêt, Gérard Lecointe a croisé la route d’ATD Quart Monde, une association créée en 1957 par le père Joseph Wresinski, qui vise l’éradication de la misère avec la participation des premiers concernés via l’émancipation par le savoir. Il s’est notamment beaucoup investi à l’université populaire d’ATD. « J’ai beaucoup souffert d’un manque d’éducation et ma Sorbonne à moi,ça a été ATD Quart Monde », explicite Gérard.
La trace des souffrances, des espérances et des résistances
Il y a cinq ans, il a versé son livre et toutes ses notes dans les archives du Centre de mémoire et de recherche Joseph-Wresinski, que l’Unesco vient de distinguer en les inscrivant le 18 mai dans son registre Mémoire du monde. « Le père Joseph Wresinski a lui-même grandi dans la misère et il savait que les pauvres ne sont pas crus quand ils parlent de leur vie, car leur récit est écrasé par celui des institutions, l’école, la police, la justice…, explique Bruno Tardieu, directeur aujourd’hui retraité du Centre Wresinski. Alors, dès son arrivée au camp d’urgence de Noisy-le-Grand en 1957, il a demandé aux volontaires qui accompagnent les familles de tout noter, pour garder la trace de leurs souffrances, mais aussi de leurs espérances, de leurs résistances et de leur façon de voir le monde. »
Photos de scènes de vie au camp de Noisy-le-Grand, lettre de désespoir de parents à qui on a retiré la garde d’un enfant, monographie d’une famille pauvre sur sept générations, enregistrements sonores du père Wresinski, témoignage sur « les mots qui blessent » ou sur la vie dans un bidonville d’Haïti, peinture par un habitant d’une cité de Créteil représentant la destruction de son quartier… Le fonds documentaire, qui démarre en 1957 et concerne 32 pays, est exceptionnellement vaste. Et il offre sur la pauvreté un regard très différent des rapports officiels car il part du point de vue de ceux qui la vivent.
Des archives accessibles en ligne
Au Centre Wresinski, à Baillet-en-France (Val-d’Oise), où il est désormais centralisé, ce patrimoine est classé selon des méthodes professionnelles grâce à une équipe d’une vingtaine de personnes. Au sous-sol, il ne faut pas moins de 10 « magasins », qui sont en fait des pièces entières, pour conserver le tout. Dans le magasin « Alligator », où sont rangées, dans des immenses rayonnages accessibles en tournant une manivelle, des montagnes d’archives papier, une température de 18 °C est maintenue. Au magasin « Guépard », où sont rangées les bobines de films, très fragiles, elle ne doit pas dépasser 15 °C.
Patiemment numérisée au fur et à mesure, la partie publication de ce patrimoine est depuis 2022 accessible en ligne. Mais les archives les plus personnelles ne le sont que sur autorisation spéciale, suivant une charte éthique. Il arrive que des personnes viennent les consulter pour rechercher les traces de leur famille. Le centre attire aussi chercheurs et étudiants. L’historienne Axelle Brodiez-Dolino, qui a compulsé ces archives pendant plusieurs années, devrait d’ailleurs sortir d’ici à la fin de l’année un livre inédit sur l’histoire d’ATD Quart Monde.
-------
Le programme Mémoire du monde de l’Unesco
L’Unesco a lancé le programme Mémoire du monde (MoW) en 1992 pour prévenir la perte ou la destruction du patrimoine documentaire. Il est composé de documents au format papier, audiovisuel ou numérique. Le programme vise à la fois à sauvegarder ce patrimoine et à le rendre davantage accessible au grand public.
En 2023, 64 nouveaux éléments du patrimoine documentaire ont été inscrits au registre international Mémoire du monde. Le registre compte aujourd’hui 494 inscriptions.
Le Comité consultatif international (CCI) est chargé de conseiller l’Unesco sur la planification et la mise en œuvre du programme Mémoire du monde. Il est composé de quatorze membres nommés par le directeur général de l’Unesco et choisis pour leur autorité dans le domaine du patrimoine documentaire.