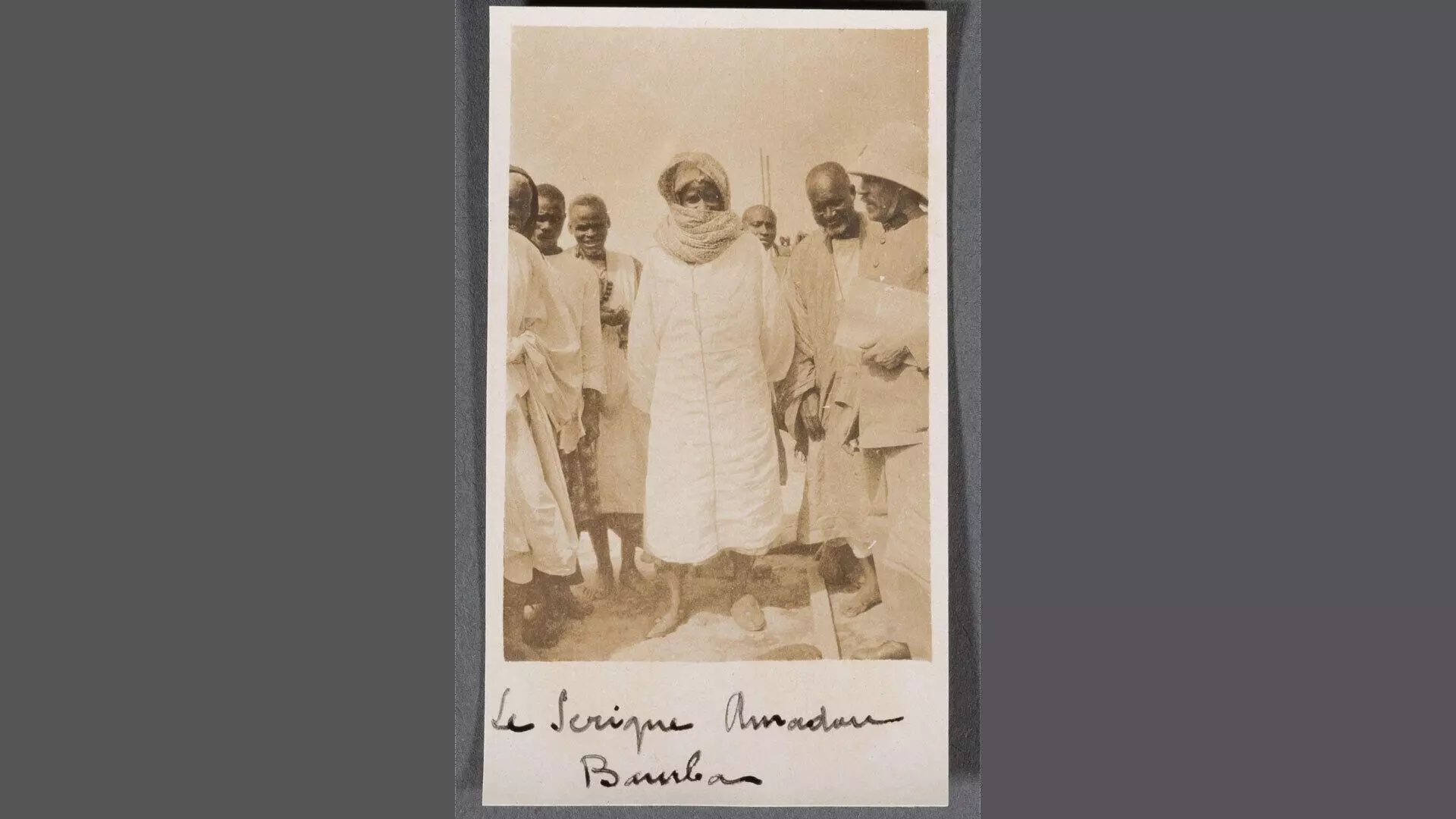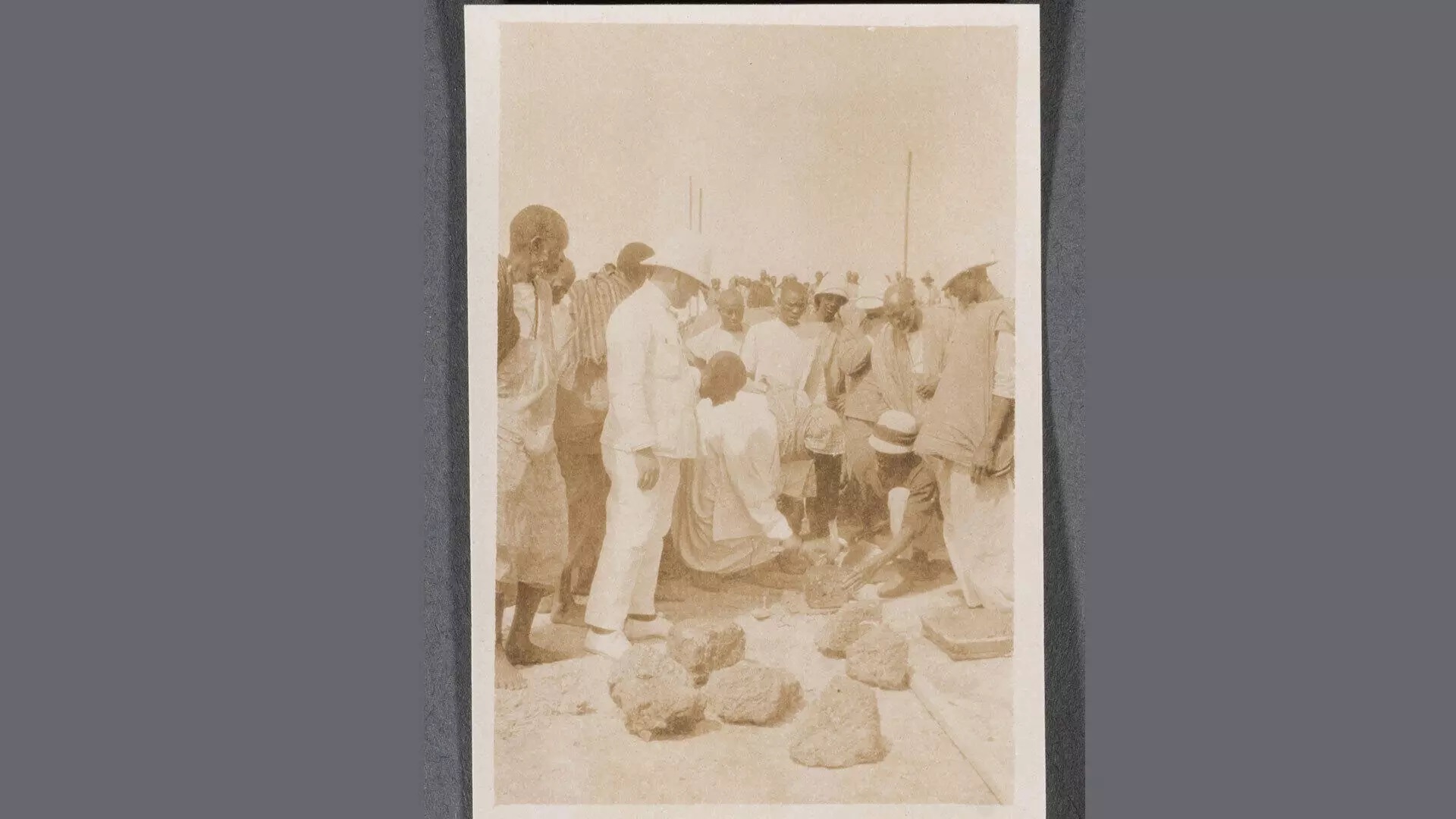Même si la récente polémique née des propos du président Kaïs Saïed peut amener à s’interroger sur l’africanité de la Tunisie, cette question n’en est pas vraiment une. Car non seulement la Tunisie est géographiquement située en Afrique mais elle a donné son nom au continent. Les Romains n’appelaient-ils pas, déjà, ce territoire « Ifriquiya » ?
Et la proximité n’est pas seulement géographique, elle est aussi – et a toujours été – culturelle. L’archéologie démontre que des échanges existaient entre le nord et le sud du Sahara dès le Néolithique : certains artéfacts, comme la céramique, portent l’empreinte d’une influence saharienne. Quelques siècles plus tard, le navigateur carthaginois Hannon entreprit un périple le long de la côte ouest de l’Afrique jusqu’au golfe de Guinée, selon les récits d’explorateurs grecs.
Certaines traditions tunisiennes sont très clairement imprégnées de réminiscences africaines. On songe, par exemple, à la légende de Bou Saadia, ce roi du Mali qui ne cesse de chercher sa fille, Saadia, en errant au rythme des tambourins et des crotales. Il emprunte les routes caravanières pour faire du commerce mais aussi pour se livrer à la traite négrière organisée pour le compte, entre autres, de l’Empire ottoman. Une pratique qui marginalisera la communauté noire de Tunisie, y compris après l’abolition de l’esclavage, en 1846, et engendrera un malaise persistant sur fond de déni de racisme.
Des traces d’africanité, on en déniche aussi dans les stambélis ou les bangas – des cérémonies rituelles saturées d’encens et de ferveur mystique, de coups de cymbales et de percussions, lorsque des marabouts comme Sidi Lasmar donnent un ton profane à l’islam. Écartées, à l’époque de l’indépendance, au nom de l’unité nationale et du progrès, ces pratiques semblables au rite des Boris, né chez les Haoussas du Niger, connaissent aujourd’hui en Tunisie un regain sans précédent.
Musique et rituels communs
Au-delà des rituels, la musique aussi tisse un lien entre la Tunisie et le sud du Sahara. À Tunis, on sait que « dimanche à Bamako est jour de mariage », on revendique sur des paroles d’Alpha Blondy, et les plus jeunes découvrent Fela et les éternels Miriam Makeba ou Manu Dibango. Tous ces musiciens, et tant d’autres, ont évolué sur les scènes tunisiennes. Le cinéma africain est, lui, au cœur des Journées théâtrales de Carthage, et les Tunisiens collaborent activement au Fespaco, à Ouagadougou.
L’Afrique n’est pas une terre inconnue de l’homo tunisianis version 2023. Leurs rapports se sont simplement distendus, avec une mise à l’écart de l’africanité tunisienne sous le régime de Ben Ali, qui penchait plus volontiers vers le Moyen-Orient ou vers l’Europe.
Pourtant, la séquence des indépendances, sur fond de panafricanisme, avait engendré de nouveaux liens fondés sur la coopération et la fraternité, surtout avec les pays de l’Afrique de l’Ouest. Le statut de pays fondateur de l’Organisation de l’unité africaine (OUA), ancêtre de l’actuelle Union africaine, a donné une crédibilité supplémentaire à la Tunisie.
Bourguiba, Senghor et Houphouët
Initiateur de cette politique, le président Habib Bourguiba estimait qu’une solidarité et des rapports étroits entre pays affranchis de la colonisation permettraient d’avoir plus de poids pour traiter, notamment, avec le général de Gaulle.
Son amitié avec le Sénégalais Léopold Sédar Senghor, son admiration pour l’Ivoirien Félix Houphouët-Boigny, sa tournée d’un mois, en 1966, qui l’a conduit dans neuf pays du continent, son adhésion active au groupe de Monrovia, la fondation de l’Agence de coopération culturelle et technique (ACCT), puis la fondation de la Francophonie lui conférèrent une stature africaine ainsi qu’une grande popularité.
Bourguiba n’était pourtant pas un « mordu » d’Afrique, mais un pragmatique : en montrant son implication en matière de partenariat et d’assistance, il tissait des liens forts. Il mettait l’expertise tunisienne à la disposition des pays amis, à défaut de pouvoir leur offrir un appui financier. Ainsi, des décennies plus tard, les ophtalmologues mauritaniens ne tarissent pas d’éloges sur l’apport de leurs confrères tunisiens, qui ont contribué à implanter la spécialité dans le pays. Et la Guinée se souvient encore que c’est la Banque centrale de Tunisie, la BCT, qui a contribué à la création de la Banque centrale de Guinée.
Ces initiatives étatiques se sont élargies, dès les années 2000, aux entreprises privées. Abderrazak Lejri, le fondateur du Groupement informatique (GI), a ainsi été parmi les pionniers du secteur bancaire africain en travaillant au Rwanda, au Mali, au Niger, au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire et au Congo.

Kaïs Saïed, au palais de Carthage, à Tunis le 2 septembre 2022. © Fethi Belaid/AFP
Parallèlement, les entreprises se lançaient à l’assaut de secteurs tels que le BTP ou l’agro-alimentaire. Cette nouvelle dynamique a rendue la Tunisie plus proche, plus attrayante pour des milliers d’Africains dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la santé. Le président Moncef Marzouki a, d’ailleurs, tenté de reprendre le flambeau de Bourguiba lors d’une visite officielle au Mali, au Niger, au Tchad et en Guinée équatoriale. Son successeur, Béji Caïd Essebsi, a également adopté un discours volontariste lors des sommets de l’UA.
L’installation de la Banque africaine de développement (BAD) à Tunis, de 2003 à 2014, a donné de la visibilité à « l’africanité économique » de son pays hôte. Simultanément, la diplomatie économique a pris le relais de la diplomatie classique, grâce notamment au Tunisian African Business Council (TABC), qui rassemblait des chefs d’entreprise et qui a conduit de nombreuses délégations d’affaires sur tout le continent.
Épisode fâcheux
Ce conseil s’est imposé comme une interface entre les gouvernements. Ce fut ainsi le cas, en 2017, lors du voyage qu’entreprit Youssef Chahed, le chef du gouvernement tunisien, au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Le TABC est aussi un organisme militant, qui souhaite aider les entreprises tunisiennes à conquérir des marchés africains – ces derniers représentent 3% des exportations du pays – et qui rappelle que le gouvernement doit accompagner cet objectif en mettant en place des conditions douanières, administratives, bancaires et de transport, minimales.
Car le constat est là : bien que le pays soit membre du Comesa (le marché commun de l’Afrique orientale et australe), membre observateur de la Cedeao (Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest), le repli de la présence tunisienne en Afrique est une réalité. Certains l’expliquent par une sous-représentation diplomatique. En effet, cinq postes d’ambassadeurs de Tunisie sur le continent sont vacants depuis plus d’un an (il y a au total 26 ambassades). Un manque à combler d’urgence si la Tunisie veut faire en sorte que sa présence soit plus visible et si elle veut renouer la confiance avec ses partenaires africains.
La diplomatie semble l’avoir compris et veut tourner la page de l’épisode fâcheux des propos du président Kaïs Saïed. Mais, pour y parvenir, il faudra que les autorités tunisiennes y mettent du leur, notamment par une présence au plus haut niveau lors du prochain sommet de l’UA. La Tunisie a tous les atouts pour réaffirmer son africanité et marquer son retour dans le sud du Sahara. Encore faut-il qu’elle décide de s’en donner les moyens.