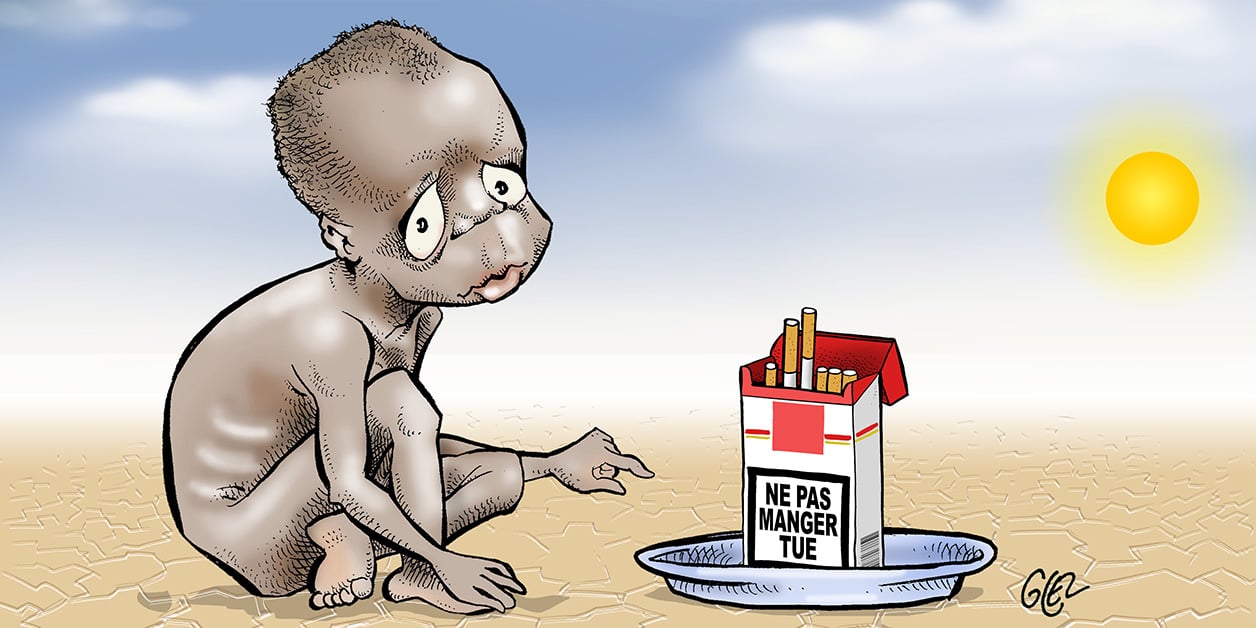Après avoir visité les provinces du Nord, Mahamat Idriss Déby Itno a entamé une nouvelle série de déplacements, cette fois dans le Sud. Ce 5 juin, le chef de l’État tchadien a pris la direction du Logone-Oriental et de sa capitale, Doba. Il y a été accueilli par le gouverneur, le général Ahmat Dary Bazine. Il a ensuite passé en revue les troupes positionnées dans la ville avant de s’entretenir avec plusieurs chefs traditionnels et religieux locaux.
« Une réponse politique » aux « forces du mal »
Son but : faire taire les critiques qui le visent depuis des semaines alors que plusieurs attaques de groupes armés ont endeuillé la province. « L’objectif est de montrer aux populations du Sud que l’État et son chef sont là pour elles, explique un conseiller de la présidence. Depuis plusieurs semaines, elles sont victimes d’attaques de groupes armés venus de l’étranger, et l’armée a été déployée. Mais il faut aussi apporter une réponse politique ».
Le 8 mai, des hommes armés avaient notamment attaqué le village de Don, dans le Logone-Oriental, tuant 17 personnes. Le chef de la communauté Kabba – à laquelle appartenaient les victimes, des agriculteurs chrétiens – avait aussitôt dénoncé des « actes lâches, barbares et ignobles » perpétrés « sous le regard impuissant et complice des autorités ». L’opposition s’était elle aussi emparé du sujet, Succès Masra décrivant des « massacres ciblés » de populations chrétiennes, tandis que Théophile Bongoro affirmait que l’État était « dépassé par les événements ».
À Doba, Mahamat Idriss Déby Itno a donc pris la parole pour revenir sur ces événements, et aussi pour ne pas laisser le champ libre à ses adversaires politiques. Dénonçant à son tour des actes « inhumains, barbares et abjects », il a affirmé que « des forces du mal » étaient à l’œuvre avec « pour ambition de replonger le Tchad dans l’abîme […] et [dans les] fractures régionalistes, religieuses et communautaristes ». Il a en outre annoncé un renforcement du contrôle des frontières et l’ouverture d’une enquête afin de déterminer les défaillances de l’administration.
« Mahamat Idriss Déby Itno est en pré-campagne »
Le chef de l’État a prévu de se rendre dans six autres provinces du Sud, et notamment à Moundou. Réputée favorable à l’opposition et volontiers frondeuse face à un pouvoir qu’elle considère confisqué par les habitants du Nord, la deuxième ville du pays avait été le théâtre d’une forte mobilisation lors des manifestations du 20 octobre 2022. Après ces événements, l’évêque de Moundou avait rendu le président responsable du « massacre » de « citoyens [qui étaient] sortis pour manifester leur mécontentement face aux injustices et face à la volonté de perpétuer un pouvoir ».
LA TRANSITION EST LE TREMPLIN IDÉAL POUR SA FUTURE CANDIDATURE
« Il faut panser les plaies du 20 octobre 2022 et répondre aux discours sécessionnistes et incendiaires de l’opposition », résume le conseiller à la présidence.
« Mahamat Idriss Déby Itno est en pré-campagne, dans la perspective du référendum constitutionnel et, surtout, de la présidentielle de 2024, affirme de son côté un ancien ministre. Le président veut se donner une envergure nationale [grâce à] la transition. C’est le tremplin idéal pour sa future candidature. »