Que lire en cette rentrée littéraire ? Au milieu des 490 romans publiés, nous vous proposons cinq romans d’écrivains africains dont les signatures sont déjà des références.
À la vie, à la mort

« Tu ne cesses de te le répéter au point d’en être désormais convaincu : une nouvelle vie a débuté pour toi il y a moins d’une heure lorsqu’une secousse a écartelé la terre alentour et que tu as été comme aspiré par un cyclone avant d’être projeté là où tu te retrouves maintenant, au-dessus d’une éminence de terre dominée par une croix en bois toute neuve. Je respire ! Je vis ! T’étais-tu à ce moment-là murmuré en signe de victoire. Mais à présent, alors que la clarté du jour pointe à l’horizon, tu n’es plus du tout habité par cette certitude. Les images qui te hantent sont plutôt celles de tes dernières heures, celles d’un trépassé cloîtré dans un cercueil et conduit en grande pompe dans sa demeure finale, ici, au cimetière du Frère-Lachaise. »
Le décor est planté. C’est par un début tragique qu’Alain Mabanckou, prix Renaudot 2006, commence son roman. Liwa Ekimakingaï, un employé de cuisine d’un palace de Pointe-Noire connaît une fin tragique un soir du 15 août, fête d’indépendance du pays. Le jeune homme pense qu’il ne devait pas mourir ce jour-là et qu’il avait encore des affaires à régler sur terre. L’auteur remonte la vie et les heures qui ont précédé la mort de son personnage. Liwa cherche désespérément à comprendre pourquoi il a été si vite arraché à l’existence. Il assiste à sa veillée funèbre de quatre jours, ressent le chagrin de sa bien-aimée grand-mère Mâ Lembé, entend le chant des louanges de ses proches qui accompagnent son âme vers les cieux, et vit son propre enterrement.
Dans Le Commerce des Allongés, Mabanckou peint une société africaine où la vie et la mort se côtoient. Cette société qui mêle croyances ancestrales et religieuses, où le monde des vivants n’est pas l’aboutissement de l’existence. Fidèle à lui-même à travers son personnage, l’écrivain décrit également une société congolaise gangrenée par la pauvreté et où la lutte des classes fait rage.
Fatoumata Diallo
Le Commerce des Allongés, d’Alain Mabanckou, Seuil, 290 pages, 19,50 euros.
Que peuvent les mots face aux guerres intimes et politiques ?

C’est l’histoire de trois amis d’enfance. Tarek, devenu berger, à qui les mots ont toujours manqué, contrairement à son frère de lait, Saïd, l’intellectuel parti étudier en Tunisie. À leurs côtés, Leïla, celle qui est restée dans leur village, El Zahra. Chacun vit ses guerres intimes parallèlement à celles traversées par l’Algérie entre 1920 et 1990. La colonisation, la Seconde Guerre mondiale, la guerre d’indépendance, le coup d’État de Boumédiene et l’arrivée au pouvoir des islamistes. Du village au Frontstalag allemand, du front de libération algérien, aux foyers de travailleurs migrants parisiens, Tarek choisit de cultiver le silence, jusqu’à le trouver pleinement lors d’une parenthèse italienne. Saïd, lui, écrit le premier roman algérien de langue arabe. Celui qui brise la vie de Leïla, sur le point de trouver refuge dans la lecture. « Dans tous mes romans, les générations n’arrivent pas à se parler », confiait Kaouther Adimi à propos de Nos richesses.
L’autrice algérienne continue de tirer le fil des mots qui manquent, à travers la solitude récurrente de ses personnages. Lesquels rencontrent, au cours de leurs vies, des figures réelles comme ici Pontecorvo et Saadi, co-réalisateurs du film mythique La Bataille d’Alger. Elle questionne aussi les mots qui trahissent, les récits qui déterminent et bouleversent les destinées. Comment, face au vent mauvais, tenir tête ? Avec une mise en abyme du roman qui se lit et celui qui s’écrit, dans un enchaînement de chapitres que l’on aurait parfois aimé voir se déployer davantage tant les riches références se succèdent, Kaouther Adimi signe un cinquième roman haletant et surprenant jusqu’à la toute dernière page.
Anne Bocandé
Au vent mauvais, de Kaouther Adimi, Seuil, 272 pages, 19 euros.
L’épopée d’un tirailleur dans l’Algérie colonisée
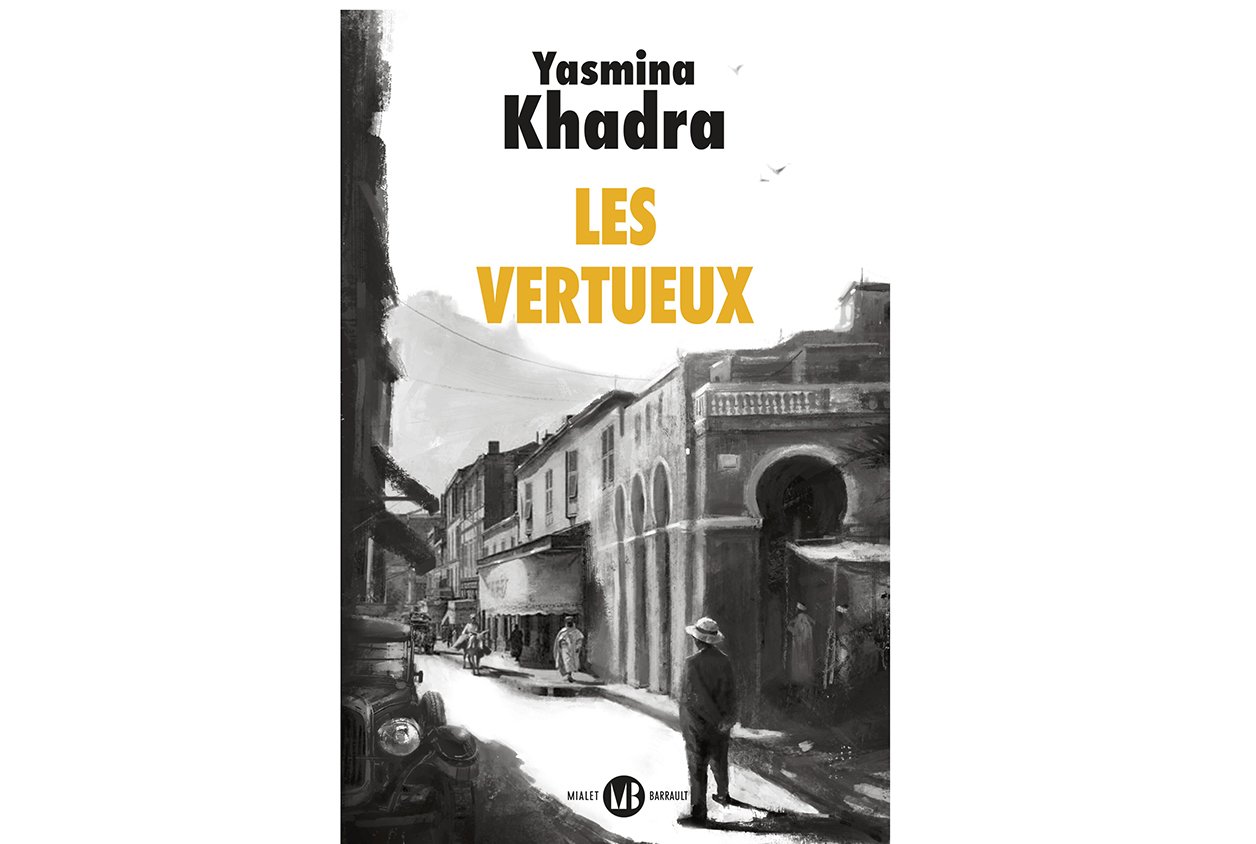
Yacine Chéraga est contraint de s’engager dans la Première Guerre mondiale à la place du fils du caïd tout-puissant de son douar. L’adulte à peine sorti de l’adolescence se retrouve incorporé au deuxième régiment des tirailleurs algériens. Le turco récolte la gloire d’un autre, devenant le caporal Hamza. Dans la première partie échevelée des Vertueux, Yasmina Khadra nous plonge dans les tranchées : son horreur et ses honneurs. Ce n’est que le début d’une fresque qui va le conduire de Sidi Bel Abbès à Kenadsa, en passant par Oran et des villages sans nom au milieu de nulle part. On y découvre l’Algérie dans tous ses contrastes : ses paysages de la ville au désert, la superposition du système féodal dans des bleds perdus et l’administration coloniale, la misère omniprésente et la rébellion des combattants pour l’indépendance… Tantôt paysan, berger, commerçant ou autre, Yacine voit sans cesse son ambition se cogner aux rebords capricieux du mektoub. Le chemin de la vertu est pavé de mille désenchantements, disparitions, abandons, chagrins, trahisons… Mais il y a aussi l’amour, la fraternité, le courage, l’espoir, la solidarité. Yasmina Khadra fait dire à l’un de ses personnages : « L’Histoire ne retiendra que les héros qui l’arrangent. » Grâce à son roman au souffle inouï, les noms de Yacine, Mariem, Abla, Sid, Zorg, Gildas, Dahmane… resteront longtemps gravés dans les mémoires.
Mabrouck Rachedi
Les Vertueux, de Yasmina Khadra, Mialet-Barrault, 541 pages, 21 euros.
Écrire pour guérir

Dis-moi pour qui j’existe ? d’Abdourahman A. Waberi, Jean-Claude Lattès, 263 pages, 20,90 euros.
Le titre est un clin d’œil à la chanson de Joe Dassin « Et si tu n’existais pas ». À l’instar du tube des années 1970, le roman est une formidable déclaration d’amour. En l’occurence, celle d’un père à sa fille. Béa n’a pas encore 7 ans et elle est atteinte d’une arthrite juvénile idiopathique. Son père suit son long combat contre cette maladie auto-immune depuis les États-Unis, où il est professeur d’université. Père et fille instaurent un rituel : un échange épistolaire. Ils évoquent l’évolution médicale de la patiente, mais aussi leur quotidien et l’histoire de la famille. Ce qui nous conduit à Djibouti, qui s’appelait le Territoire français des Afars et des Issas (TFAI) quand Abdourahman Waberi y est né, en 1965. On retrouve la veine autofictionnelle du précédent roman de l’écrivain franco-djiboutien, Pourquoi tu danses quand tu marches ? On renoue ainsi avec sa galerie de personnages : outre Béa, il y a Papa la Tige, la mère Zahra et la grand-mère charismatique, Cochise, surnom donné en référence au chef amérindien. Énormément de tendresse, un hommage aux personnels soignants et une leçon : « Il faut dévider le fil de nos récits d’hier et d’aujourd’hui. Ils sont facteurs de guérison. »
Mabrouck Rachedi
Dis-moi pour qui j’existe ? d’Abdourahman A. Waberi, Jean-Claude Lattès, 263 pages, 20,90 euros.
Cacao et chocolat

Entre la douceur du chocolat et l’amertume du cacao, le nouveau livre de Gauz’, né à Abidjan en 1971, est une variation toute personnelle autour de l’histoire de la Côte d’Ivoire, vue à travers le prisme de la production de cacao. Des débuts de la colonisation à la prise du bunker de Laurent Gbagbo, Gauz’ nous raconte, avec une verve inspirée et un humour acide, le poids que peut représenter la culture des fameuses fèves, trop peu transformées sur place. Dans la tête d’un colon, cela donne ça : « Tous, on va les coller à la culture du cacao. On va les spécialiser à ça même. On a déjà testé sur les côtes. Ils ont les mêmes brousses tropicales qu’aux Amériques d’où on a ramené les plants. Ces terres nouvelles seront un garde-manger où notre “nourriture” est produite par ceux que la nature et l’histoire y ont paresseusement déposés. Ce serait un comble que ça nous coûte alors qu’ils sont si vigoureux. Occuper une terre, c’est aussi occuper ses habitants, surtout quand ils n’y foutent rien depuis des millénaires. »
Bien entendu, truffé de références et d’allusions, ce texte qui part un peu dans tous les sens parlera surtout aux Ivoiriens. Pour les autres, il fait plusieurs fois référence au personnage principal du roman de Roald Dahl Charlie et la chocolaterie, Willy Wonka, et à ses employés les Oompa-Loompas. « Il est blanc, Willy Wonka / Et alors? / Il est blanc et grand… Les Oompa-Loompas sont noirs et petits / Mais qu’est-ce que tu racontes papa, ils sont pas noirs les Oomps-loompas, ils sont blancs, j’ai vu le film / Dans le film, ils sont blancs. Oui ! Mais dans le roman, ils sont noirs, petits de taille et vivent en Afrique. » Grinçant, on vous dit.
Nicolas Michel
Cocoaïans (naissance d’une nation chocolat), de Gauz’, L’Arche, 112 pages, 14 euros.







