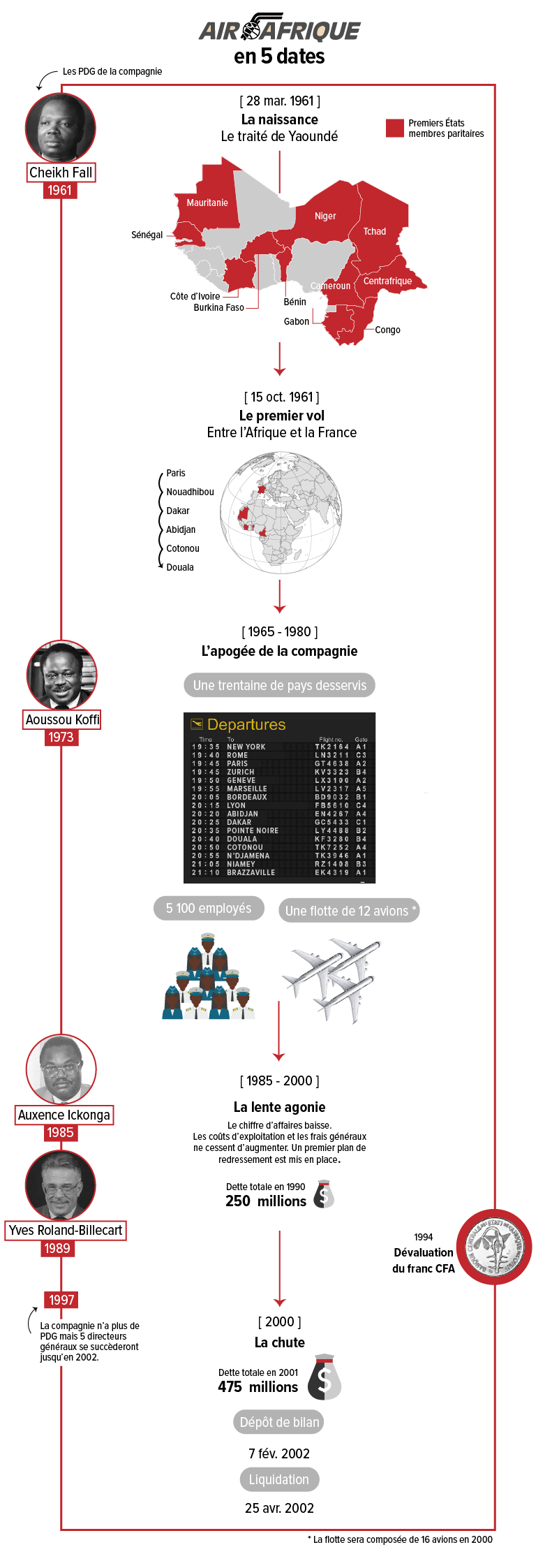L’enquête sur l’« islamo-gauchisme » à l’université réclamée par la ministre de l’Enseignement supérieur est une tentative pour faire taire les spécialistes des études postcoloniales dans une France prisonnière de ses fantômes et de ses dénis.
En France, les récents propos de la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Frédérique Vidal, sur l’« islamo-gauchisme » – qui aurait « envahi » l’université et imposerait désormais sa « domination » sur les sciences sociales –, a suscité de nombreuses réactions.
Au-delà du débat engendré, et la volonté de certains d’instaurer un nouveau maccarthysme dans l’univers de la recherche, d’en faire une affaire « franco-française » sur un mal « venu d’Amérique » – les études postcoloniales, sur le genre ou la démarche intersectionnelle –, cette polémique relayée par les médias concerne aussi le passé colonial et la relation historique de la France avec l’Afrique. L’histoire coloniale est vécue comme un « boulet » par les élites politiques, qui n’ont jamais su comment socialiser cette question pour assumer et dépasser ce long épisode historique.
Débats violents
Nous proposons ici, en tant que spécialistes de la « question coloniale » et africanistes, un autre regard sur ce mois de février 2021, une quinzaine d’années après la désormais célèbre loi sur le passé colonial de février 2005, marquée par son article 4 sur l’obligation d’enseigner « les aspects positifs de la colonisation », qui avait alors déclenché des débats tout aussi violents. Députés et sénateurs français avaient voulu imposer aux historiens un regard à la fois bienveillant et normatif sur le passé colonial de la France. Un an après, Jacques Chirac avait fait déclasser ce fameux article 4.
Les tribunes, articles, appels et textes polémiques publiés à quinze ans d’intervalle dans le prolongement de ces deux affaires ont de manière assez similaire dénoncé plusieurs secteurs de la recherche. La confusion entre activisme militant et recherche universitaire – notamment concernant les travaux sur l’histoire coloniale et postcoloniale, qui sont dans les deux cas dénoncés – brouille de manière similaire notre capacité à porter un regard sans passion sur le passé colonial.
https://www.jeuneafrique.com/wp-content/themes/ja-3.0.x/assets/img/mondial2018/quote-article.png") left top no-repeat;">
LES RÉACTIONS AU RAPPORT STORA MONTRENT QUE CE PASSÉ EST ENCORE AU CŒUR D’UNE VIVE TENSION EN FRANCE
Comme en 2005, le monde de la recherche a réagi en 2021 avec justesse et courage. Les présidents d’université et la direction du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) se sont indignés devant la condamnation par la ministre française des courants de recherche évoqués plus haut, qui font partie désormais des aventures de la pensée mondiale. À l’étranger, les critiques ont été générales.
« Purifier » l’histoire coloniale
En périphérie de ces débats, l’histoire coloniale critique demeure la cible centrale pour une multitude de polémistes. Ainsi, les réactions au rapport Stora sur les mémoires de la guerre d’Algérie, remis au président de la République française en janvier 2021, montrent que ce passé est encore au cœur d’une vive tension en France (mais aussi en Algérie).
Nous sommes désormais entrés dans la deuxième phase d’un processus qui entend marginaliser, voire « purifier » l’histoire coloniale, particulièrement les recherches critiques sur ce passé. En 2005, ce sont les néo-réactionnaires qui étaient à l’œuvre et relayaient le vote des députés et sénateurs. On pouvait alors les classer politiquement plutôt à droite et à l’ultra-droite, avec quelques ex-soixante-huitards devenus des intellectuels conservateurs, tels que Pascal Bruckner, Max Gallo ou Alain Finkielkraut. Ils étaient accompagnés par certains militants de l’« anti-repentance », à l’image de Daniel Lefeuvre ou Michel Renard.
Jean-Pierre Rioux souligne alors les enjeux de mémoire autour de ces questions dans son livre La France perd la mémoire. Répondant à notre ouvrage La fracture coloniale, publié en 2005 aux éditions La Découverte, il précisait que « la fracture ou le hiatus — seuls des travaux d’histoire pourront départager ces mots — que nous vivons aujourd’hui à propos de la colonisation et de l’esclavage dans le cours de la mémoire française procèdent plutôt des « trous » de mémoire en métropole comme chez les descendants des victimes, tant ils rameutent des souvenirs souvent confus et disparates, parfois reconstruits, toujours exigeants et même vindicatifs […] ».
Déni et travail de sape
Pour analyser ce retour du refoulé colonial, nous avons proposé La Fracture coloniale et, cinq plus tard, Ruptures postcoloniales, qui cherchaient, entre autres, à comprendre les mécanismes du repli sur soi de la pensée républicaine et réactionnaire, repli dans lequel la question coloniale joue le rôle moteur d’un impensé et d’un déni.
La revue Sciences humaines écrivait alors : « Laissant s’exprimer des positions nuancées, l’ouvrage Ruptures postcoloniales indique peut-être la possibilité de sortir désormais, selon l’expression de la chercheuse Marie-Claude Smouts, du « manichéisme délirant » qui fait de l’alternative « choix ou refus d’une posture postcoloniale » une « lutte entre le bien et le mal ». Ce qui supposera sans doute de quitter le ciel des théories pour affronter le terrain raboteux de l’enquête en sciences sociales… »
Dans cette dynamique, nous avons renouvelé en 2016 notre analyse avec Vers la guerre des identités ? De la fracture coloniale à la révolution ultranationale, portant un bilan global de ces enjeux et annonçant les tensions à venir puis, en 2017, nous l’avons prolongée dans un ouvrage collectif publié aux États-Unis The Colonial Legacy in France (Indiana University Press). Deux livres qui annonçaient, en partie, ce que nous vivons aujourd’hui.
Nous n’avions, il faut le reconnaître, aucun mérite : ce qui arrive aujourd’hui en France était plus que prévisible. C’est la réaction et le travail de sape d’une partie des élites intellectuelles de droite puis d’une partie de la gauche, contre le travail sur le passé colonial, qui porte ses fruits et éclaire la configuration actuelle.
https://www.jeuneafrique.com/wp-content/themes/ja-3.0.x/assets/img/mondial2018/quote-article.png") left top no-repeat;">
CETTE CAMPAGNE POLÉMIQUE VIOLENTE REMET EN CAUSE TOUTE LECTURE CRITIQUE DE L’HISTOIRE COLONIALE
Cette entreprise se résume dans une phrase de Max Gallo, qui voyait dans ces recherches sur les « violences coloniales », ou celles articulant périodes coloniale et postcoloniale, un danger imminent, propice à ce que « la France s’agenouille ». Nous en sommes là, et l’épisode de février 2021 n’est que le dernier avatar de ce lent processus à l’œuvre depuis deux décennies.
Des chercheurs marginalisés
Car ne nous y trompons pas, cette campagne polémique violente, la volonté de désigner et marginaliser des chercheurs, de placer au ban de la société des travaux critiques sur la colonisation et la postcolonie — à travers le rejet univoque des études postcoloniales — remet clairement en cause toute lecture critique de l’histoire coloniale. Cette situation interroge donc la capacité de la société française à poursuivre un travail en profondeur sur cette histoire, en dépassant la polémique pour enfin envisager une approche apaisée.
Déjà en 2010, Jean-François Bayart avait provoqué un débat brûlant avec Les études postcoloniales. Un carnaval académique (Karthala). Mais cet ouvrage avait le mérite de demeurer dans le champ des controverses intellectuelles. En effet, Jean-François Bayart, comme Jean-Loup Amselle, sont des universitaires qui travaillent et connaissent leur sujet (même si nous ne partageons pas leurs analyses), qui ont lu les études sur le passé colonial ou le postcolonialisme, ce qui n’est pas le cas des polémistes actuels, tels Pierre-André Taguieff ou Gérard Noiriel.
« Après la fracture coloniale, la fracture académique ? En France, les critiques se font de plus en plus nombreuses vis-à-vis du courant des études postcoloniales, synthétisait alors la revue Sciences humaines. Symbolisé par la parution de l’ouvrage collectif La Fracture coloniale en 2005, ce courant, très développé dans le monde anglo-saxon, souligne la prégnance d’un « héritage colonial » dans le rapport de la société française à ses immigrés, qu’il s’agisse des discriminations persistantes, des problèmes des banlieues ou des « guerres de mémoire » autour de la guerre d’Algérie par exemple. Le message politique se double d’une ambition scientifique invitant en particulier à intensifier les recherches en histoire coloniale et à analyser les dimensions imaginaire et culturelle de cet héritage. Le débat politique, on le sait, reste vif. »
À partir de ces premières empoignades, la décennie s’annonçait tumultueuse et la réaction ne pouvait qu’être violente.
Boîte de Pandore
Un premier moment de basculement peut être identifié, en 2011, lors d’un discours prononcé aux Rendez-vous de l’histoire de Blois (un espace de visibilité des controverses historiographiques) par Pierre Nora et repris par le quotidien Le Monde le 15 octobre 2011. Le titre est explicite : « La question coloniale : une histoire politisée. » Il écrit : « La question coloniale est venue brutalement, depuis une dizaine d’années, faire changer d’échelle les tensions entre histoire et politique ; elle a porté sur grand écran la politisation interne de l’histoire. » Il fait remonter ce « basculement » à la loi Taubira, en 2001, « qui criminalisait l’esclavage et la traite atlantique » et à un livre de 2003, Le livre noir du colonialisme, dirigé par Marc Ferro.
https://www.jeuneafrique.com/wp-content/themes/ja-3.0.x/assets/img/mondial2018/quote-article.png") left top no-repeat;">
LA MAJORITÉ DES CHERCHEURS SERAIT SOIT DES « DÉCOLONIAUX », SOIT DES LIBRES-PENSEURS MARTYRISÉS PAR CES « MILITANTS »
Pour Pierre Nora, il s’agit « non plus d’inscrire la colonisation au grand registre de l’histoire nationale, mais de réécrire cette histoire nationale à la lumière noire de la colonisation. » Et de conclure, en prenant comme point d’orgue la guerre d’Algérie : « L’intensité de l’affaire algérienne a rejailli sur l’ensemble de l’affaire coloniale, devenue une crise de conscience vite refermée et mal digérée » en France. Rouvrir cette boîte de Pandore, ce serait mettre en péril le récit national, autoriser une histoire critique de la République menaçant ses fondements mêmes, et instaurer la division entre les descendants des immigrations postcoloniales et la société française.
Pierre Nora formulait alors le fil conducteur du processus qui va suivre pendant dix ans et conduit à la déclaration de la ministre début 2021, visant à « remettre l’histoire à l’endroit ». Ce qui aurait pu – et dû — n’être qu’un débat d’universitaires et de chercheurs, devient un débat idéologique d’où naîtra le monstre conceptuel de l’« islamo-gauchisme ». D’ailleurs, Pierre Nora a signé plusieurs des tribunes récentes contre la recherche postcoloniale.
Apocalypse à l’université
En 2016, le processus s’accélère. Les débats sont alors nombreux au sein de l’Éducation nationale, mais aussi sur le « retour du colonial » dans l’arène politique, avec notamment François Fillon qui offre aux Français sa lecture de la colonisation lors des primaires en 2016, en affirmant que la guerre au Cameroun et l’implication de la France avant et après l’indépendance, n’ont jamais existé.
La déclaration d’Emmanuel Macron en Algérie, qualifiant la colonisation de « crime contre l’humanité », apporte une contradiction nette à cette posture. De scientifique, le débat se fait politique et l’histoire coloniale de la France en Afrique en est devenu un enjeu central.
Pendant trois ans, cette dynamique se poursuit pour construire un contre-discours à celui du candidat Emmanuel Macron, devenu président de la République. En novembre 2018, une tribune/pétition signée par 80 intellectuels et universitaires, intitulée « Le “décolonialisme”, une stratégie hégémonique » décrit une véritable apocalypse à l’université, où la majorité des chercheurs serait soit des « décoloniaux », soit des libres-penseurs martyrisés, empêchés par ces « militants » de travailler et de débattre.
Si aucun exemple n’est donné, le nom des victimes s’étale sur une demi-page. Déjà, la confusion s’installe entre des groupes militants minoritaires et radicalisés — tel le Parti des indigènes de la République (dont les militants combattent nos travaux depuis des années) —, des noyaux d’étudiants radicalisés entreprenant d’interdire à Alain Finkielkraut ou Sylviane Agacinski de parler – ce qui est clairement condamnable –, et des chercheurs, peu nombreux, travaillant sur l’intersectionnalité, la colonisation et la postcolonie. Cette confusion est volontaire : il s’agit de fabriquer un groupe social cohérent, désigné à la vindicte publique comme le nouvel ennemi de la République.
Fake news et insultes
L’offensive se poursuit avec une tribune publiée en avril 2019 dans Marianne et intitulée « L’offensive des obsédés de la race, du sexe, du genre et de l’identité », qui tire de nouveaux à boulets rouge sur les universitaires ayant soi-disant rompu avec l’« idéal républicain ».
https://www.jeuneafrique.com/wp-content/themes/ja-3.0.x/assets/img/mondial2018/quote-article.png") left top no-repeat;">
LE BUT : FAIRE DE TOUT CHERCHEUR SUR LE PASSÉ COLONIAL UN ENNEMI POTENTIEL DE LA RÉPUBLIQUE…
Le troisième étage de la fusée est lancé en décembre 2019 dans L’Express avec un article délirant emmené par Pierre-André Taguieff et Laurent Bouvet intitulé « Les bonimenteurs du postcolonial business en quête de respectabilité académique », créant la confusion entre chercheurs et militants, histoire coloniale, chercheurs postcoloniaux et militants décoloniaux.
Accumulant fake news, insultes et approximations, ce texte vise à délégitimer toute recherche « irrespectueuse » (à leurs yeux) sur le passé colonial de la France. Le but : faire de tout chercheur sur le passé colonial un ennemi potentiel de la République… sauf s’il fait allégeance aux idées promues par le Printemps républicain ou affirme son adhésion à l’« anti-repentance » théorisée par Daniel Lefeuvre, et bien avant lui par Bernard Lugan (alors proche du Front national).
Guerre idéologique
Car parallèlement, fin novembre 2019, un parti politique, le Printemps républicain — animé notamment par Laurent Bouvet (professeur de sociologie), le préfet Gilles Clavreul et quelques autres —, est fondé entendant « restaurer » l’idéal républicain. Ce mouvement politique manifeste aussi la première jonction idéologique avec la droite « anti-repentance » coloniale, qui désormais dévore un pan de la gauche qui a basculé vers un discours guerrier dirigé contre cet « ennemi ».
Ils n’ont pas les mêmes origines idéologiques, mais leurs chemins se croisent désormais avec un objectif commun : s’attaquer à l’histoire coloniale ou aux chercheurs postcoloniaux, les désigner comme des militants décoloniaux… Simultanément est créé sur internet le collectif « Vigilance université », dans lequel on retrouve nombre d’intellectuels conservateurs à l’origine des pétitions et tribunes, et qui sont dans le domaine de la colonisation relayés par le site polémique Études coloniales.
Enfin, début janvier 2021, on découvre un « Observatoire du décolonialisme » animé par les mêmes petits groupes d’activistes, qui recense toutes les interventions de groupes radicalisés et dresse la liste des chercheurs à abattre. C’est à l’issue de ce processus que l’« islamo-gauchiste » et l’anti-repentance deviennent les porte-étendards d’une guerre idéologique dont on mesure aujourd’hui la violence.
Raz-de-marée médiatique
Face à un tel processus, la recherche sur le passé colonial est désarmée, car elle n’est pas d’un bloc — les points de vue et les approches sont logiquement diverses — et surtout elle n’engage aucune guerre idéologique — sauf pour quelques militants décoloniaux radicalisés que nous condamnons ici comme nous avons condamné dans Le Monde, dès mars 2005, Les Indigènes de la République et les dangers d’une vision du monde essentialisant la « race ».
https://www.jeuneafrique.com/wp-content/themes/ja-3.0.x/assets/img/mondial2018/quote-article.png") left top no-repeat;">
PARMI CEUX QUI CRITIQUENT LES TRAVAUX SUR LA COLONISATION OU LES ÉTUDES POSTCOLONIALES, TRÈS PEU EN SONT SPÉCIALISTES
Les chercheurs sur le passé colonial ou la postcolonie sont en effet bien incapables de répondre avec les mêmes armes à cette offensive idéologique, concrétisée par un raz-de-marée médiatique. En outre, la plupart des acteurs et signataires de cette nouvelle croisade sont des personnalités, des mandarins, qui ont un accès massif aux médias (diffusant leurs idées dans L’Express, Le Point, Marianne, Valeurs actuelles, Le Figaro…), ou des universitaires installés ou retraités exerçant ou ayant exercés des magistères dans leur domaine.
Très peu sont d’ailleurs spécialistes de la colonisation ou des études postcoloniales. Pour autant, ils se donnent le droit de critiquer les travaux émanant de ces champs de la recherche, en emmenant avec eux quelques historiens en quête de notoriété ou partisans d’une nouvelle croisade de l’Occident contre l’« anti-France ». Dès lors, ils imposent des oukazes sur le travail d’historiens et de chercheurs, dénoncent livres, colloques, recherches, films et expositions. La méthode : dénigrer et prétendre que tous ces travaux n’ont aucune valeur scientifique.
Il faut aussi s’attaquer à toute diffusion du savoir vers le grand public. Par exemple, le film Décolonisations. Du sang et des larmes diffusé en octobre 2020 sur France 2 a été violemment attaqué dans Le Figaro par Pierre Vermeren — qui a signé certaines de ces tribunes polémiques —, suggérant que montrer les crimes coloniaux perpétrés durant les décolonisations était une manière d’armer les terroristes islamiques. Nous le retrouvons d’ailleurs aussi « en soutien » aux côtés de plusieurs historiens et personnalités d’un texte ultra-critique contre le rapport de Benjamin Stora sur les mémoires de la guerre d’Algérie, accusé de prendre le parti des Algériens.
Pierre Vermeren est désormais en campagne pour prendre dans les prochaines semaines la tête de la Société française d’histoire des outre-mers (SFHOM) et imposer dès lors son magistère dans le monde des chercheurs et universitaires sur le passé colonial. Après les derniers scandales et démissions à la tête de la SFHOM, ce serait une prise majeure.
Ainsi se dessine le dernier objectif de cette stratégie : interdire aux chercheurs de travailler ou contrôler la production scientifique sur le passé colonial et la postcolonie, au nom de l’intégrité nationale et de la France éternelle. Il est rare et déprimant de vivre une telle période de régression intellectuelle, mais il est essentiel de comprendre d’où elle vient.
Chasse aux sorcières
Depuis 2005, La fracture coloniale est perçue comme l’ouvrage qui, pour la première fois, autorise à comprendre pourquoi et comment le passé colonial avait changé non seulement les colonies, mais la France elle-même, et d’envisager les répercussions de l’histoire coloniale sur la France sur le long terme.
Si les critiques et polémiques sur cette perspective d’analyse sont toujours aussi vives, les événements récents confèrent une actualité à cette fracture, et valide ironiquement la possibilité de les lire depuis l’histoire de l’Empire. Disons-le, nous n’imaginions pas une telle postérité au début de notre travail sur la fracture coloniale. Mais surtout, nous mesurons le décalage entre l’Afrique et le reste du monde qui entament une lecture critique de ce passé, et la France qui semble prisonnière de ses fantômes et de ses dénis.
https://www.jeuneafrique.com/wp-content/themes/ja-3.0.x/assets/img/mondial2018/quote-article.png") left top no-repeat;">
LE TRAVAIL DES HISTORIENS DU COLONIAL EST INDISPENSABLE, EN FRANCE COMME DANS TOUS LES PAYS AFRICAINS
Cependant, la configuration est complexe : en France, des chercheurs, des intellectuels, des artistes, des cinéastes, des auteurs travaillent avec lucidité sur ce passé. Nous ne sommes pas tous d’accord et c’est très bien ainsi. Certains puisent une partie de leurs grilles d’analyse dans les études postcoloniales, d’autres moins, mais tous les travaux sur la colonie et la postcolonie ont une valeur propre, qu’il s’agit de soumettre à la discussion.
Nous sommes assez grand pour nous opposer aux décoloniaux les plus radicaux et aux nostalgiques les plus agressifs, qui rêvent de réinventer les méthodes de MacCarthy et de faire d’un Pierre-André Taguieff le chef d’une chasse aux sorcières aussi dangereuse que le « mal » qu’il prétend combattre.
Mais il y a encore en France des dizaines de chercheurs et d’universitaires qui se battent pour le droit de faire des conférences, de débattre et de travailler. Si la prochaine étape qui se prépare vise vraisemblablement à faire taire les historiens du colonial, leur travail est indispensable, en France comme dans tous les pays africains, même (et peut-être surtout) lorsqu’il bouleverse les États en place, les élites dominantes, les mémoires historiques ou les identités figées. L’histoire est devenue un sport de combat, et au regard de la situation en France, nous n’en sommes qu’au premier round.