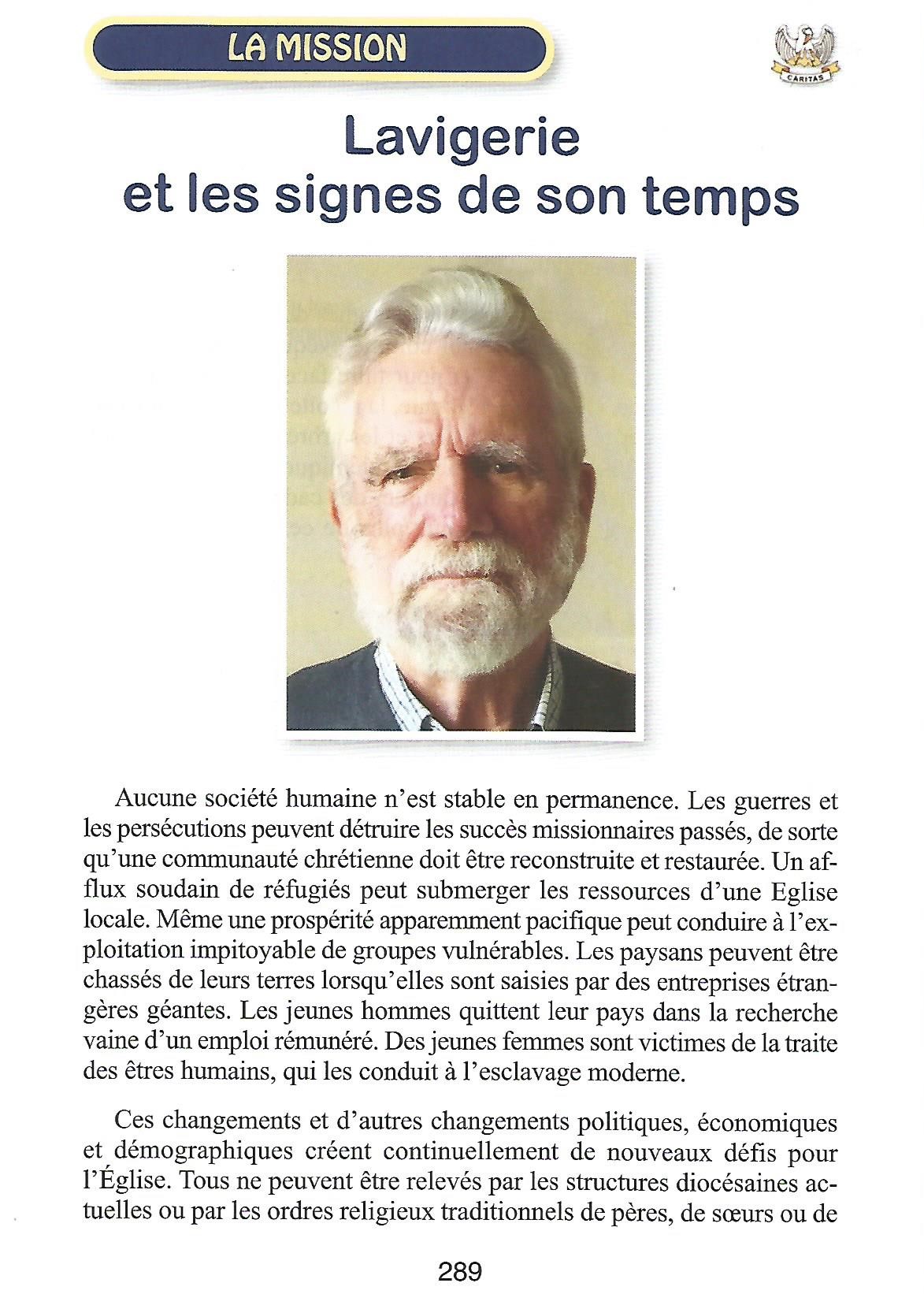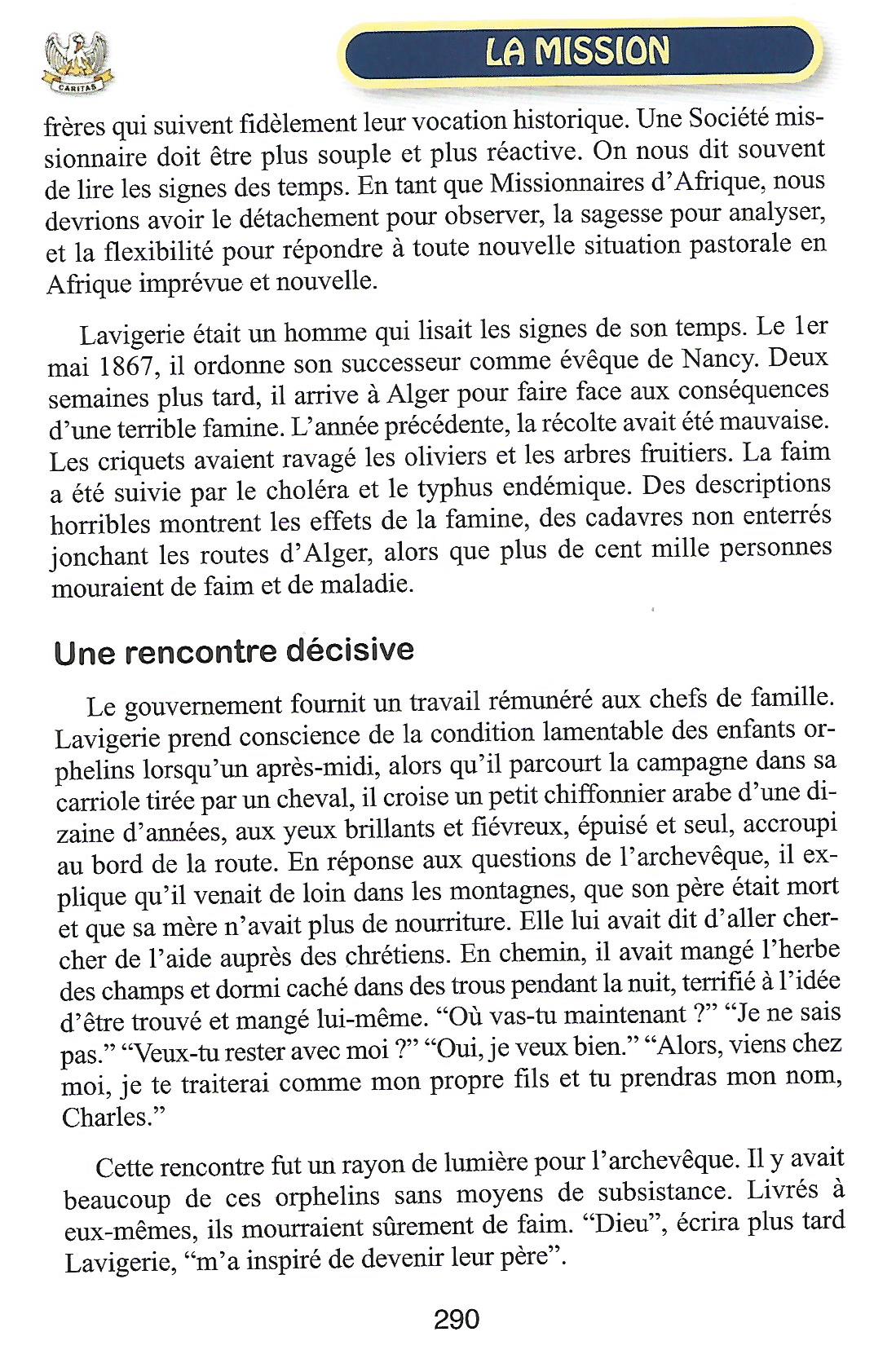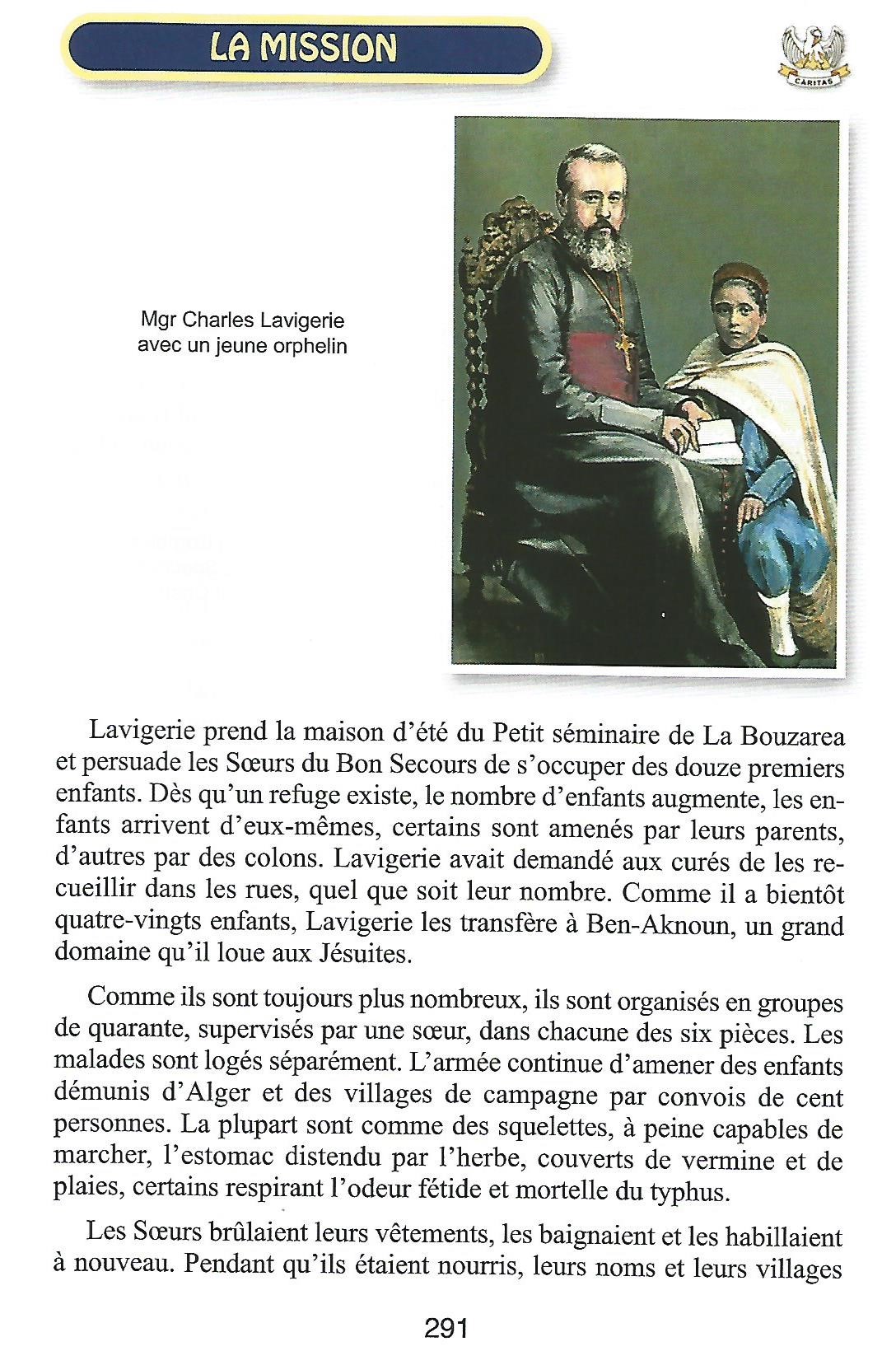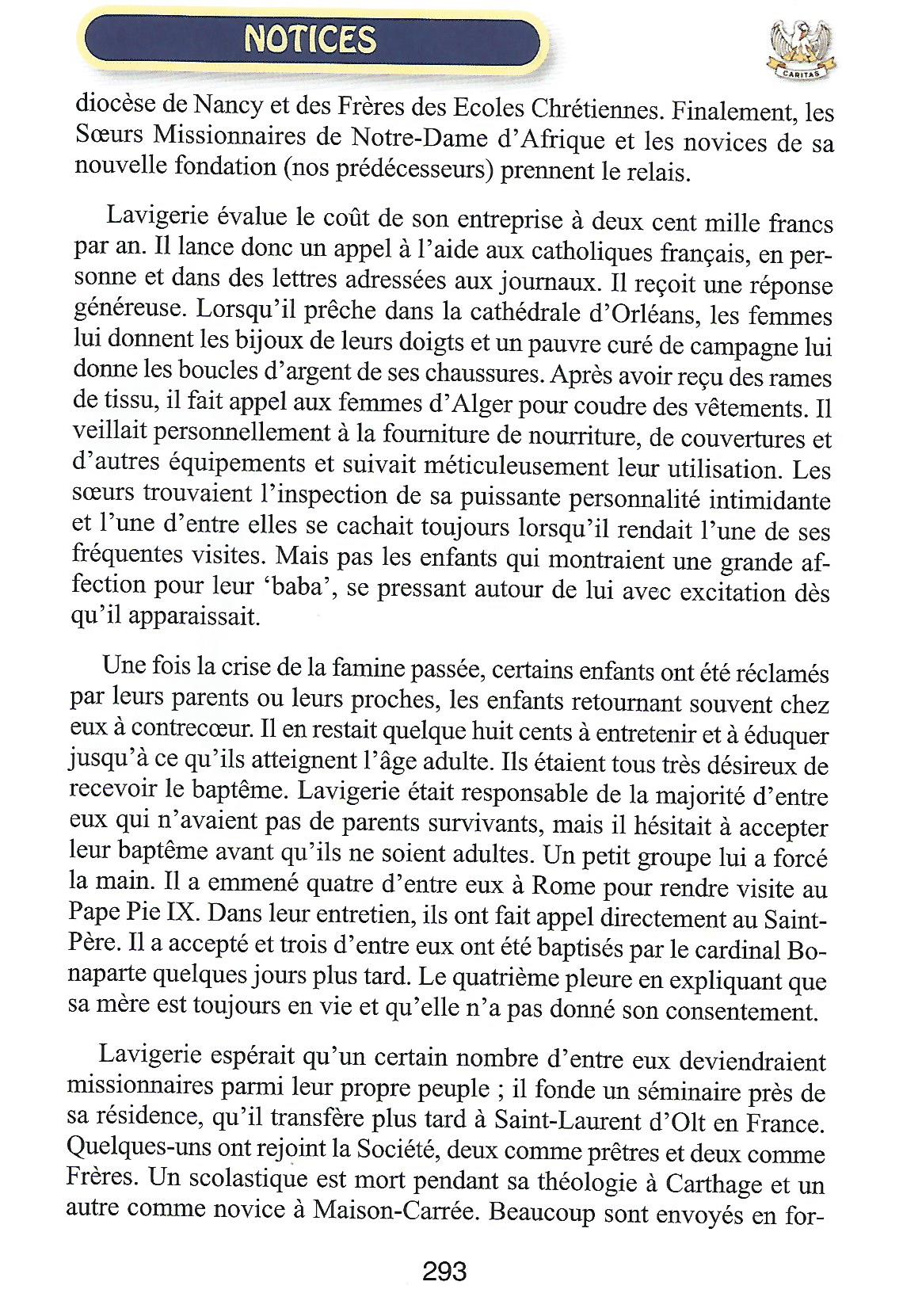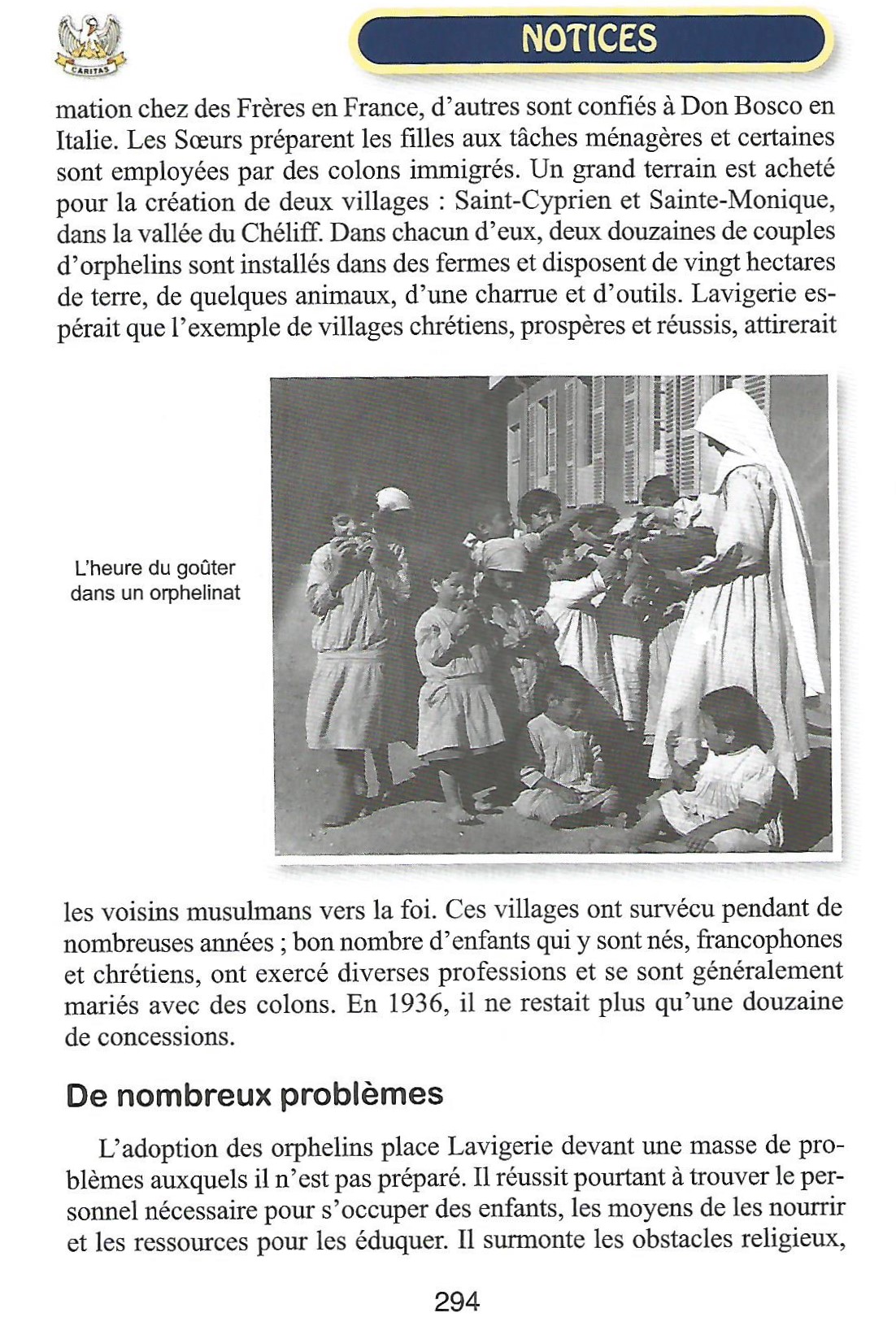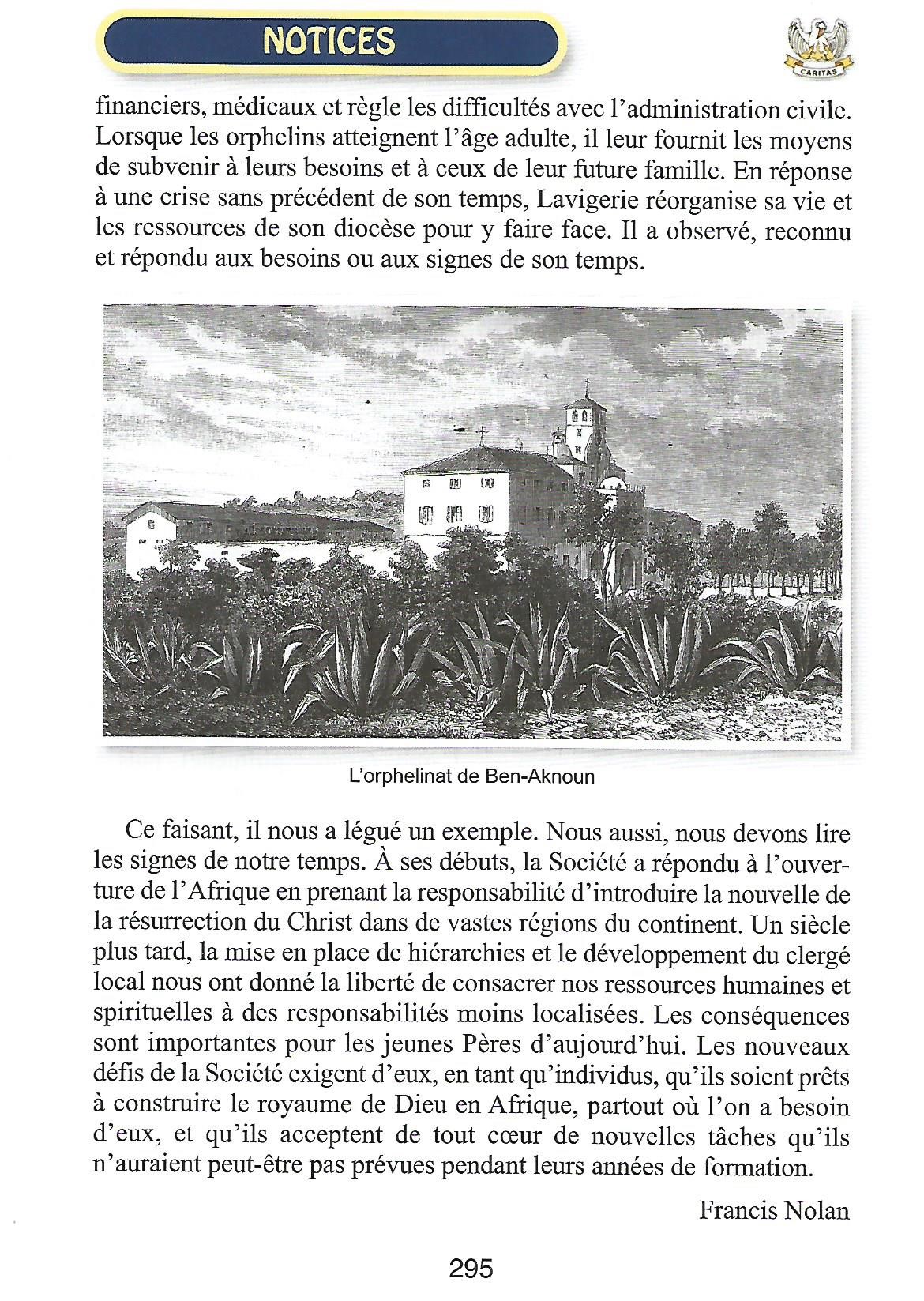Dinars tunisiens. © Dinars tunisiens. √Ǭ© Vincent FournierJA ©Vincent Fournier/Jeune Afrique
Saviez-vous que le mot dinar vient du latin et dirham du grec ? Jeune Afrique a cherché pour vous l’origine du nom des monnaies africaines. En voici une sélection.
Le continent compte une quarantaine de devises, leurs dénominations témoignent d’une histoire multiséculaire entre influences gréco-romaines et arabo-musulmanes, legs coloniaux et traditions autochtones.
Racines gréco-latines
Le dinar, utilisé aujourd’hui en Algérie, en Libye, au Soudan et en Tunisie, vient du latin denarius, littéralement « qui contient dix ». À l’origine, le denarius fut utilisé comme monnaie sous la République romaine, le terme s’est ensuite exporté dans plusieurs régions du monde. Il a été traduit en grec, en espagnol (dinero signifie « argent ») et en arabe.
L’historien français Fernand Braudel (1902-1985) disait ainsi que la Méditerranée n’était « pas une civilisation, mais des civilisations entassées les unes sur les autres ».
Parité (au 12 juillet 2021) : 1 € = 159,4 DZD (Algérie) ; 1 €= 3,2 TND (Tunisie)
La devise officielle du Maroc, le dirham, tire, elle, son nom du grec drakhmê. Ce terme renvoie aux monnaies grecques en circulation sous l’Antiquité, notamment autour du bassin méditerranéen, et dans la Grèce moderne jusqu’à l’arrivée de l’euro
En 1959, trois ans après son indépendance, le Maroc a abandonné le franc marocain pour rétablir le dirham comme monnaie officielle. Il avait été instauré au VIIIe siècle par Idris Ier, considéré comme le premier souverain chérifien
Parité (au 12 juillet 2021) : 1 € = 10,6 MAD (Maroc)

Huit pièces de denarii romains. © Wikimedia Commons/Licence CC
Influence arabo-musulmane
D’autres monnaies ont des noms d’origine arabo-musulmane. C’est le cas, par exemple, du Mozambique et de sa monnaie le metical. En circulation depuis 1980, son nom est tiré de l’unité de mesure arabe mithqal, valant 4,25 grammes.
Il en va de même pour l’ouguiya, la devise de Mauritanie. Ce mot vient de l’arabe awqiya, qui signifie once, soit entre 15 et 34 grammes.
L’origine d’une dénomination peut être plurielle. Il en va ainsi pour l’ariary malgache qui dérive de l’arabe al ryal. Le rial est une monnaie de certains pays du Moyen-Orient, notamment de l’Arabie saoudite. Le terme vient lui du portugais real que l’on peut traduire dans ce contexte précis par royal, faisant, comme pour le franc, référence au seigneuriage.
Legs coloniaux
- Colonisation française
La période des colonisations européennes, plus proche de nous dans le temps, a durablement transformé les systèmes monétaires du continent. À commencer par le franc CFA encore « perçu comme l’un des vestiges de la Françafrique », selon le président français Emmanuel Macron.
Le franc CFA est actuellement utilisé dans 14 pays en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale. Ceux-là sont répartis en deux zones, pour qui le sigle CFA ne signifie pas exactement la même chose : c’est le franc de la Communauté financière africaine en Afrique de l’Ouest et le franc de la Coopération financière en Afrique centrale.

Aucun des arguments en faveur du franc CFA n’a la puissance émotionnelle des objections qu’il suscite. © Vincent Fournier/JA
De même, le sigle CFA n’a pas eu la même signification. Au moment de sa création, en 1945, il signifiait « franc des Colonies françaises d’Afrique ». Il deviendra de 1958 à 1960 le « franc de la Communauté française d’Afrique ». Par la suite, avec la décolonisation, le f de français disparaîtra pour laisser place à f comme financier.
Concernant le mot « franc », deux origines lui sont souvent attribuées : certains estiment qu’il découle de l’allemand frei (libre). D’autres s’appuient sur l’année 1360, date à laquelle le roi de France Jean II le Bon fait frapper les premiers francs sur lesquels on lit la formule latine Francorum rex (« le roi des Francs »).
Le franc est, en outre, utilisé dans des pays qui ne font pas partie de la zone CFA, à savoir Djibouti, la Guinée, le Rwanda, le Burundi et la RDC. Le franc congolais a été la monnaie officielle sur l’ensemble du XXe siècle des différentes entités politiques ayant existé, excepté entre 1967 et 1997 où Mobutu Sese Soko a mis en place le zaïre.
- Colonisation britannique
La colonisation britannique a elle aussi laissé des traces. On retrouve notamment la livre égyptienne ou la livre sud-soudanaise. Le terme « livre », aujourd’hui relativement peu utilisé en français, désigne une unité de masse. Une livre équivalait à environ 327 grammes dans le système métrique romain.
Le shilling est lui aussi un vestige du passage britannique en Afrique. Le mot est dérivé du vieil anglais scilling, lui-même issu du latin solidus. Le solidus était une monnaie romaine qui a vu le jour au IVe siècle. Le shilling est aujourd’hui en circulation au Kenya, en Tanzanie, en Ouganda et en Somalie.
Parité (au 12 juillet 2021) : 1 € = 18,58 EGP (Égypte)
- Colonisations espagnole et portugaise
Le dobra, monnaie officielle de Sao Tomé-et-Principe, vient du portugais dobrão qui signifie doublon. Le doublon était une monnaie utilisée dans la péninsule ibérique entre le XVe et le XIXe siècle
La monnaie de la Sierra Leone, le leone, tire son origine de l’espagnol leone (lion). Le nom même du pays signifie « la montagne du lion », qui a été donné en 1462 par le navigateur portugais Pedro da Cinda.

50 000 dobras, monnaie de Sao Tomé-et-Principe. © Wikimedia Commons/Licence CC
- Colonisation néerlandaise
L’Afrique du Sud, après son retrait du Commonwealth au début des années 1960, a choisi de délaisser la livre sud-africaine pour adopter le rand comme monnaie officielle.
Le terme de rand est issu de l’afrikaans, langue elle-même dérivée du néerlandais, et renvoie au mot Witwatersrand, chaîne de collines qui s’étend sur près de 280 kilomètres. En français, on peut traduire cette chaîne par « crête des eaux blanches » , et par extension rand par crête.
Parité (au 12 juillet 2021) : 1 € = 16,85 ZAR (Afrique du Sud)
- Origines africaines
Plusieurs monnaies ont des origines autochtones. La monnaie érythréenne, le nakfa, a une portée hautement symbolique. Nakfa est en effet le nom porté par une ville au nord du pays, symbole de la première victoire significative du Front populaire de libération de l’Érythrée (FPLE) contre le gouvernement éthiopien pendant la guerre d’indépendance (1961-1991).
La monnaie ghanéenne, le cedi fait également référence à l’histoire nationale. Cedi veut dire « petit coquillage » ou « cauri » en langues Akan, parlées par plus de neuf millions de personnes dans la région. Or, les coquillages, les cauris en particulier, furent pendant longtemps utilisés comme monnaie en Afrique de l’Ouest.
D’autres monnaies africaines ont une signification quasiment littérale, qui renvoie à l’argent (comme métal). Il est en va du birr éthiopien, qui vient de l’amharique, la langue officielle du pays avec l’anglais, du lilangeni (Eswatini) et de la roupie – signifiant plus exactement « argent forgé », du sanskrit rupya. La roupie est utilisée à Maurice et aux Seychelles, deux pays comptant une forte population issue du sous-continent indien.
La monnaie botswanaise, le pula, provient du tswana pula (pluie), dans un pays semi-aride recouvert en partie par le désert du Kalahari !
Enfin, certaines monnaies ont une origine géographique. Le loti, du Lesotho, correspond à la forme singulière de Maloti-Maluti en sotho du Sud (une langue d’Afrique australe), ce dernier nom étant porté par une chaîne de montagnes traversant le pays et une partie de l’Afrique du Sud.
Le kwanza angolais découle du fleuve homonyme, l’un des principaux du pays. Le naira tire aussi, indirectement, son nom d’un fleuve, puisqu’il est dérivé du mot « Nigeria » ; le pays ayant été nommé ainsi par le gouvernement britannique en 1886, en référence au troisième fleuve d’Afrique, le Niger.
Enfin le kwacha vient du nyanja, langue parlée en Zambie et au Malawi. Les deux pays l’ont l’adoptée comme nom de leur devise, au lendemain de l’indépendance. En français, kwacha signifie tout simplement « aube »…

50 000 dobras, monnaie de Sao Tomé-et-Principe. © Wikimedia Commons/Licence CC