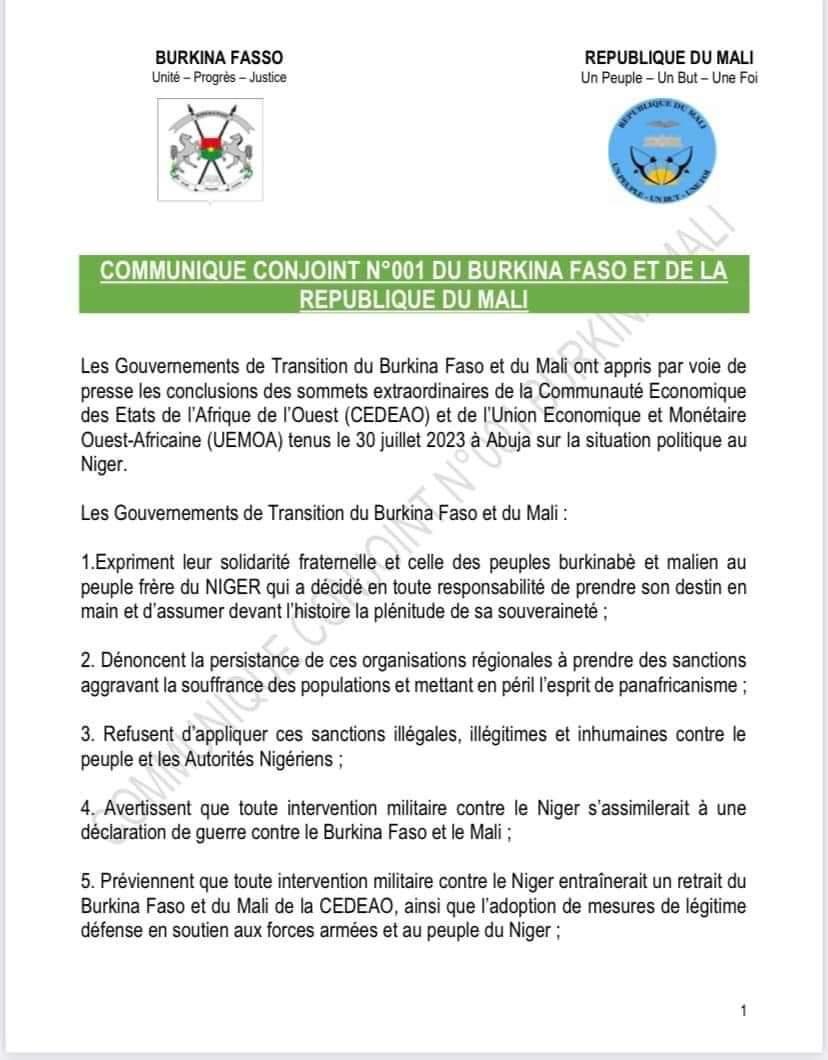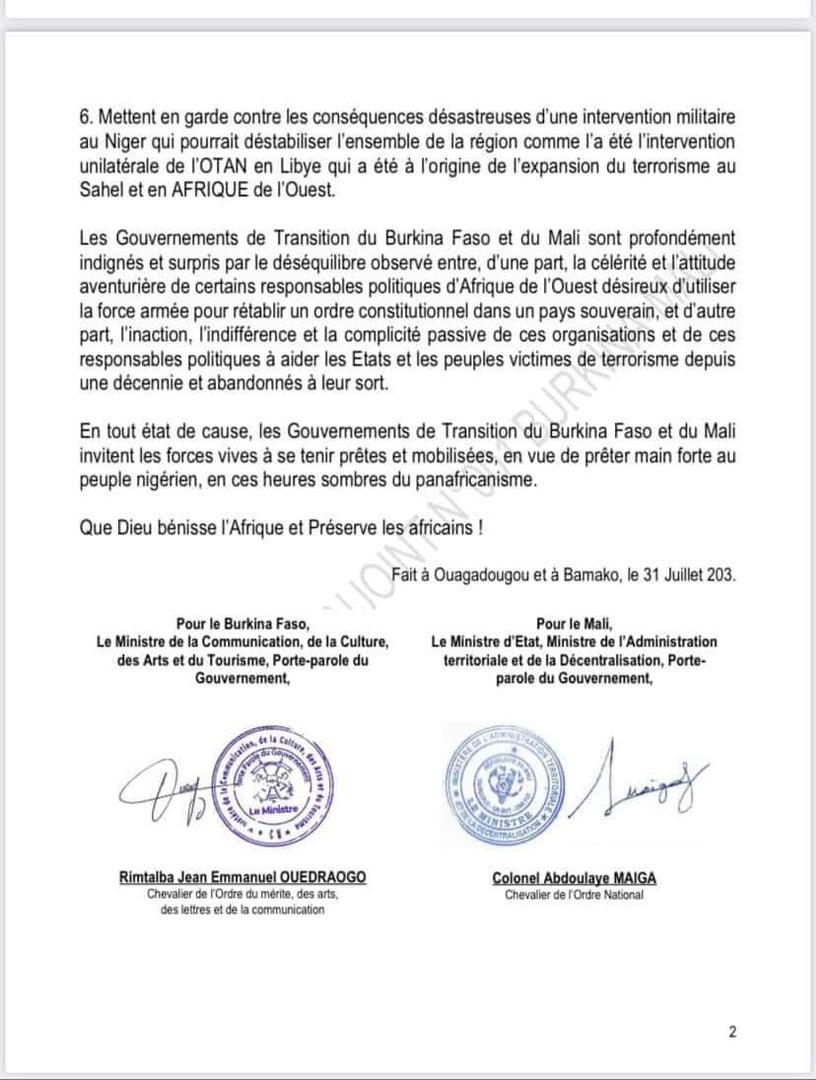La ville de Fana, dans le sud du Mali, où ont eu lieu dix assassinats, avec dix têtes coupées. © MONTAGE JA : MICHELE CATTANI/AFP
CES AFFAIRES CRIMINELLES QUI ONT PASSIONNÉ L’AFRIQUE (5/5) – Il y avait bien eu quelques saisies de cannabis, des soupçons d’abattage illégal d’ânes pour revendre leur viande, parfois même des vols de bétail. Mais, à en croire les journaux locaux, rien, en matière de criminalité, ne distinguait Fana des autres communes du Mali.
Jusqu’en 2018 du moins. À partir du 13 mai de cette année-là, cette localité de 36 000 âmes, située au bord de la nationale, à 130 km à l’ouest de Bamako, fait la une de la presse. L’affaire, reprise dans les médias internationaux, verse dans l’horreur : onze assassinats, onze têtes coupées – dont deux n’ont jamais été retrouvées. Des victimes de tous âges, dont le sang aurait parfois été prélevé, à en croire les enquêteurs.
Pendant trois ans, Fana a vécu au rythme de ces assassinats sordides, jusqu’à l’interpellation, en août 2021, d’un homme d’une quarantaine d’années. Dans l’attente de son jugement, il est détenu à la maison d’arrêt centrale de Bamako.
Les atrocités commencent avec le meurtre de Ramata Diarra. La fillette, âgée d’à peine cinq ans, est la première de la série macabre. Son assassinat provoque une onde de choc au Mali. Aux premières heures de l’enquête, la thèse d’un crime rituel est privilégiée. Ramata était en effet atteinte d’albinisme, une affection génétique qui suscite craintes et superstitions sur le continent. La mort de l’enfant fait réagir des personnalités, comme le musicien Salif Keïta, très engagé dans la défense des albinos. Mais l’hypothèse est vite abandonnée car la seconde victime, elle, n’est pas porteuse de ce trouble de la pigmentation. L’enquête reprend à zéro.
Une fillette, un réparateur de radio, un gardien
Pendant que les décapitations se succèdent, la police peine à identifier des suspects. Les éléments matériels retrouvés sur les scènes de crime ne donnent rien. Et il n’y a pas de lien apparent entre les victimes (dont les noms n’ont pas tous été rendus public à ce jour). Rien, donc, qui permette de remonter jusqu’au tueur.

Un gendarme malien, le 30 juin 2020, devant la maison où le corps d'un ancien soldat a été retrouvé décapité vingt jours plus tôt. © MICHELE CATTANI/AFP
Que peuvent bien avoir en commun une fillette albinos, un ancien soldat, un électricien et le gardien d’une antenne relais ? Il faudra attendre la dixième victime pour obtenir une ébauche de réponse. Dans la nuit du 1er au 2 août 2021, Aghibou Bagayoko, un vendeur ambulant âgé d’une vingtaine d’années, est retrouvé décapité, chez lui, à Fana.
Les services de police, qui connaissaient bien le jeune homme, passent au crible ses fréquentations. Le procureur de la ville, Boubacar Moussa Diarra, fait procéder à l’interpellation de tous les membres de son grin – au Mali, ce terme désigne un groupe informel qui se réunit pour discuter et prendre le thé dans un lieu donné.
Parmi ses fréquentations, banales, se distingue un certain Aldiouma Djibo. Ce quadragénaire isolé, sans profession ni domicile fixe gravite autour du groupe de jeunes. À l’époque, il partage la chambre d’Aghibou Bagayoko, qui a accepté de l’héberger temporairement. Les habitants du quartier de Badialan, dont sont originaires plusieurs des victimes, le connaissent bien. Il traîne ses guenilles dans le coin, « a l’air d’un fou », rapportent certains témoins, mais « s’exprime très bien », et personne ne le pense dangereux.
Depuis la mort d’Aghibou Bagayoko, Djibo a pourtant disparu. Les services de police croient dans un premier temps qu’il est mort, victime lui aussi du décapiteur en série. Mais, quelques jours plus tard, on l’aperçoit dans une station-essence de la capitale, où il est appréhendé. Niant toute implication, le suspect affirme d’abord avoir pris la fuite en entendant les assassins arriver. Son récit ne convainc pas les enquêteurs : pourquoi n’a-t-il pas pris soin de prévenir son voisin de chambrée, afin qu’il puisse également se sauver ?
Colère et vengeance
Les mois passent. Enfermé entre les quatre murs d’une cellule, Djibo refuse de passer aux aveux devant le procureur. Il commence toutefois à se confier à ses codétenus, leur confesse ses crimes et dit sa crainte d’en subir les conséquences. Il finira par reconnaître tous les faits, le 22 décembre 2022. Objets emportés, description précise des lieux… Il donne des détails « que seul l’assassin pouvait connaître », confie une source judiciaire.
Ses aveux permettent de comprendre son mobile. « L’ensemble des meurtres ont été commis à la suite d’altercations avec les futures victimes », explique notre interlocuteur. Le meurtre de Ramata n’échappe pas à la règle. « Il visait la mère de l’enfant. Quelques jours plus tôt, il aurait eu une querelle avec elle au marché. Mais, lorsqu’il s’est rendu dans leur maison, elle était absente. Il s’en est donc pris à sa fille pour se venger », poursuit-il.
Les autres décapitations s’expliqueront, à quelques détails près, de la même manière. « Il passe à l’acte quand on le menace, résume une source qui a enquêté sur l’affaire. Il tue de peur d’être tué. »
Le meurtre de Bemba Traoré, électricien ? Ce dernier aurait mal réparé la radio que Djibo lui avait confiée, et aurait refusé de le rembourser. La onzième et dernière victime, un marginal qui vivait dans la rue, à Bamako ? Il aurait menacé Djibo, pensant que celui-ci tentait de lui dérober ses effets.
Zones d’ombre

Devant l'entrée de la Maison centrale d'arrêt de Bamako, le 3 juillet 2020. © MICHELE CATTANI/AFP
Le meurtrier présumé, qui risque jusqu’à la peine de mort (elle n’est cependant plus appliquée au Mali), n’a pas encore livré tous ses secrets. Une information judiciaire est en cours. Son état de santé mentale sera évalué afin qu’il soit jugé en conséquence.
Autre point à élucider : a-t-il bénéficié de complicités ? Pour le savoir, les autorités judiciaires devront déterminer si le sang des victimes a bien été recueilli par le ou les tueurs. « Si elles avaient été égorgées tandis qu’elle étaient encore en vie, ce qui reste à établir, il aurait dû y avoir beaucoup de sang sur les scènes de crime. Or ce n’était pas le cas. Cela pourrait signifier que le sang a été récupéré et que le suspect avait des complices », précise une source proche du dossier.
Reste une ultime question, sans doute la plus délicate : pourquoi le tueur en série a-t-il décapité ses victimes ? « Il a expliqué qu’il avait choisi ce mode opératoire pour être sûr qu’elles seraient bel et bien mortes et ne pourraient pas le dénoncer », confie notre interlocuteur.
C’est aussi par superstition que le meurtrier présumé a emporté certaines têtes, convaincu que l’image d’un assassin reste imprimée sur l’iris de sa victime. Deux fois, alors, il s’est assuré que personne ne pourrait voir son visage dans les yeux des défunts.
Une série en cinq épisodes :