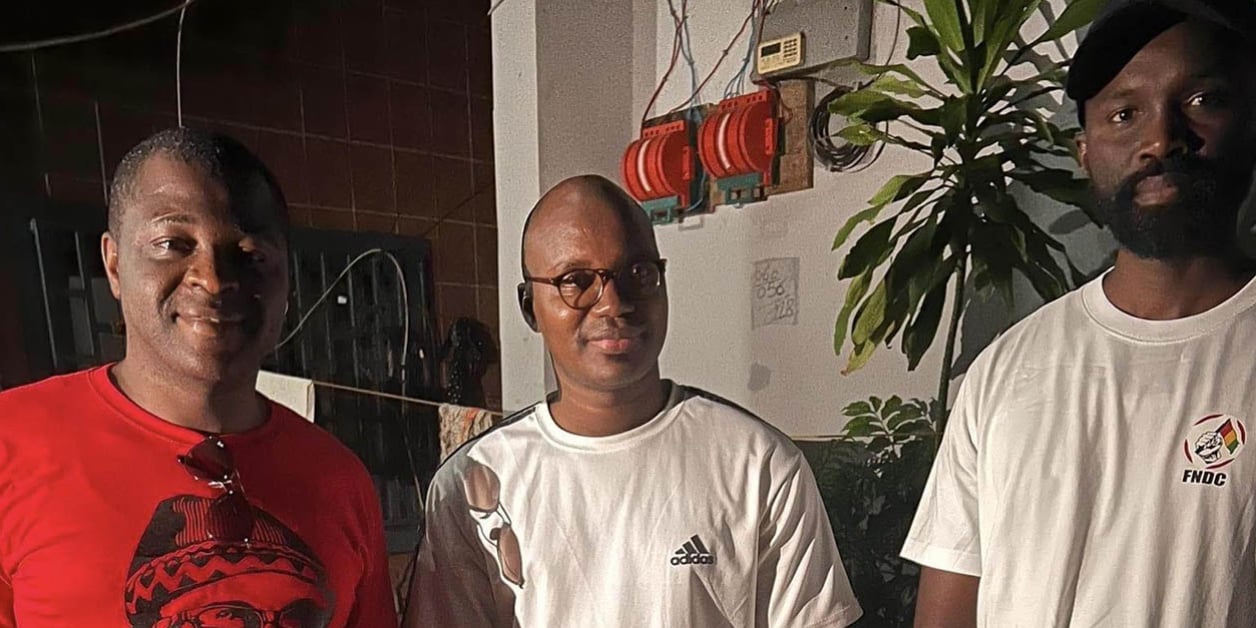WAGNER, LES NOUVEAUX PILLEURS DE L’AFRIQUE (2/2)
• Les mercenaires russes ont monté deux sociétés minières et tentent depuis de récupérer des permis miniers avec l’appui d’hommes d’affaire maliens. Leur intérêt pour l’or s’est décuplé depuis le début de la guerre en Ukraine.
• Selon nos informations, les hommes d’Evgueni Prigojine se sont également lancés dans l’orpaillage artisanal, investissant au moins trois sites au sud de Bamako, et dans le trafic d’or via Dubaï, plaque tournante de son commerce illégal.
La légende dit de lui qu’il est l’homme le plus riche de tous les temps. Son immense fortune, Kankan Moussa, qui a régné au début du XIVe siècle sur l’empire du Mali, l’a bâtie sur les tonnes d’or dont regorgeaient ses sous-sols. Sept siècles plus tard, les réserves maliennes du précieux métal sont loin d’être épuisées et attisent toujours les convoitises.
Quand il débarque à Bamako, en juillet 2021, Sergueï Laktionov a pour mission d’élaborer un schéma précis de ce potentiel aurifère. Ce géologue russe de 54 ans, parfaitement francophone, est apparu sur les écrans radars des services de renseignement occidentaux en travaillant pour les intérêts miniers de Wagner en Centrafrique.

Le président de la transition au Mali, Assimi Goïta, avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, à Bamako, le 7 février 2023. © Présidence de la République du Mali
Visite de mines
Depuis quelques semaines, son patron, Evgueni Prigojine, négocie l’arrivée de ses hommes avec la junte d’Assimi Goïta. Les grandes lignes du contrat commencent à prendre forme : environ 1 400 mercenaires contre 10 millions de dollars par mois. Avec, comme en Centrafrique, où le groupe paramilitaire est arrivé fin 2017, l’objectif de se rémunérer en puisant directement à la source, dans les mines d’or.
Au cours de ses premières semaines de prospection sur les anciennes terres de Kankan Moussa, Sergueï Laktionov visite plusieurs sites miniers dans le sud du pays. Il a aussi plusieurs rendez-vous avec le ministre des Mines et de l’Énergie, Lamine Seydou Traoré. Avant d’être poussé à la démission, le 31 mai, en raison – officiellement – des graves problèmes de délestages électriques à travers le pays, ce quadragénaire ambitieux, ancien cadre chez Orange Mali, a longtemps été un personnage influent du régime de transition.
Il est surtout très proche d’un des piliers de la junte : son beau-frère, le colonel Sadio Camara, russophile ministre de la Défense et artisan du partenariat avec Wagner. Une relation quasi filiale connue de tous et qui, selon certains, aurait surtout fait de lui la victime collatérale d’une rivalité croissante entre Camara et Goïta.

Le colonel Sadio Camara, ministre malien de la Défense, à Bamako, le 19 août 2020. © MALIK KONATE/AFP
La piste Menankoto
Grâce à son ministère ô combien stratégique et à son pouvoir d’attribution des titres miniers (qui lui a été retiré fin 2022, après le lancement d’un audit du secteur par le ministère des Finances), Lamine Seydou Traoré était devenu l’un des hommes les plus courtisés de Bamako. Il était, aussi, accusé par certains de largement profiter de ses prérogatives et soupçonné de corruption.
Auprès de l’ancien ministre des Mines, Sergueï Laktionov essaie d’abord de récupérer certains permis d’exploitation. Parmi eux, celui de Menankoto, où Lamine Seydou Traoré a évincé la major canadienne B2Gold début 2021 pour y imposer une petite société inconnue dans le secteur minier : Little Big Mining, dont un des trois actionnaires n’est autre qu’un de ses cousins, Aboubacar Traoré.
Les responsables de Wagner se méfient-ils du litige (et donc d’une éventuelle exposition publique) autour de cette mine ? La jugent-ils pas assez rentable à court terme ? Ou est-ce plutôt la junte qui s’est opposée à cette opération ? Difficile à dire, mais l’opération ne se fera jamais et B2Gold récupèrera finalement le permis de Menankoto quelques mois plus tard, fin 2021.
Intermédiaire malien
Pas de quoi faire reculer Wagner pour autant. Alors que les premiers mercenaires de la « Compagnie » s’apprêtent à débarquer à Bamako, en décembre 2021, Sergueï Laktionov et son collègue Viktor Popov continuent à travailler sur le volet minier dans le plus grand secret.
Andreï Mandel, patron de la société M-Invest – une filiale de Wagner – au Soudan, est lui aussi dépêché au Mali pour y structurer les futures activités minières du groupe. Comme dans les autres pays du continent où Prigojine s’est implanté, décision est prise de monter des filières locales et de s’appuyer sur des intermédiaires pour ne pas apparaître en première ligne.
Fin 2021 est donc créée la société Alpha Development par Bakin Gassimi Guindo. Cet homme d’affaires, neveu d’un ancien ministre d’Ibrahim Boubacar Keïta, a démarré dans le secteur minier au milieu des années 2000 avec son entreprise Gold Resources du Mali, puis s’est diversifié dans l’informatique et la production audiovisuelle.
C’est surtout une vieille connaissance d’Aboubacar Traoré. Le 19 février 2021, quatre jours après avoir cofondé Little Big Mining, ce dernier procède à la refonte des statuts d’une autre de ses sociétés, Baris Travaux, qu’il a créée en 2011, pour y faire entrer Bakin Gassimi Guindo au capital. Les deux hommes en détiennent désormais 50 % chacun.
Selon une copie de l’acte notarial consultée par Jeune Afrique, l’objet de la société est également modifié : au BTP et à la commercialisation de matériaux de construction s’ajoutent désormais « la recherche et l’exploitation des mines et carrières ». Quelques mois plus tard, Baris Travaux décroche le permis d’exploitation pour la mine de Bakolobi, convoitée, elle aussi, par les canadiens de B2Gold – avant de leur être finalement revendu en avril 2022.
Financer l’effort de guerre
« C’est probablement Lamine Seydou Traoré qui a dû souffler le nom de Bakin Gassimi Guindo aux gens de Wagner lorsqu’ils cherchaient un intermédiaire malien, estime un homme d’affaires. Ils avaient déjà travaillé ensemble sur le dossier Bakolobi et cela aurait été trop grossier de placer son propre cousin. » D’après les services de renseignement français, Guindo aurait été recruté directement par Sergueï Laktionov. Une autre source malienne évoque ses « rendez-vous nocturnes avec des Russes » dans un bar connu de la rue Princesse, à Bamako.
Contacté par Jeune Afrique, Bakin Gassimi Guindo reconnaît avoir créé la société Alpha Development, mais affirme en être « le seul actionnaire » et n’avoir « aucun lien avec Wagner ». Pour le reste, il refuse d’en dire davantage. Dans ses différentes démarches administratives à vocation minière pour le compte de ses partenaires russes, il collabore avec le notaire Mohamed Zouboye, fils de Fatimata Zouboye, ancienne présidente de la chambre des notaires de Bamako. Lui aussi contacté par Jeune Afrique, Mohamed Zouboye « ne souhaite pas s’exprimer » sur ce sujet, se disant « lié par le secret professionnel ».
Durant le premier trimestre 2022, une seconde société à vocation minière est montée par Wagner à Bamako, probablement selon le même modèle : Marko Mining. Parallèlement, le groupe paramilitaire, désormais pleinement engagé en Ukraine, où Vladimir Poutine a déclenché la guerre le 24 février, tente de passer à la vitesse supérieure pour tirer profit des mines maliennes. Prigojine cherche toujours plus d’or pour soutenir le déploiement de ses mercenaires sur le front ukrainien et poursuivre ses différentes opérations militaires et d’influence en Afrique.
Parmi les analystes occidentaux, certains estiment que les lingots collectés par Wagner aux quatre coins du continent pourraient aussi servir directement les intérêts de Poutine et renflouer les réserves du Trésor russe. « Depuis l’invasion de l’Ukraine, la Russie puise dans les caisses pour financer son effort de guerre et couvrir son déficit, explique une source haut placée à Paris. Les autorités russes pourraient acheter l’or du groupe Wagner de façon opaque en roubles pour ensuite pouvoir effectuer des paiements auprès de ses partenaires, comme la Chine, l’Inde ou l’Iran. La Chine a par exemple augmenté ses importations d’or russe en 2022. Cette solution permettrait à Wagner de blanchir son or tandis que Moscou essaie de limiter la dépréciation du rouble. »
Des permis d’exploitation très convoités
En avril 2022, Sergueï Laktionov revient donc à la charge auprès de ses interlocuteurs maliens. Il plaide pour un schéma de nationalisation des mines d’or et entend récupérer les permis d’exploitation de gisements déjà opérationnels. Il en cible notamment trois, parmi les plus prolifiques du pays : Fekola, exploité par B2Gold ; Loulo-Gounkoto, détenu par un autre minier canadien, Barrick Gold ; et enfin Syama, aux mains de l’australien Resolute Mining.

La mine de Syama, au Mali. © Philip Mostert/Resolute Mining
Aux sièges de ces différents miniers, l’information provoque quelques sueurs froides sans toutefois susciter plus d’inquiétude que ça. « Il est impossible de retirer comme ça un permis d’exploitation pour le délivrer à un autre opérateur, affirme l’avocat de l’un d’entre eux. Les autorités maliennes savent très bien ce que nous leur rapportons et ce à quoi elles s’exposeraient si elles se risquaient à de telles pratiques. »
À Bamako, d’autres sources se montrent moins catégoriques. « Les sociétés minières sont soutenues par des grands fonds d’investissement étrangers – américains, chinois ou autre – qui, en cas de litige, font pression pour le régler par voie diplomatique classique, explique un professionnel du secteur. Mais il ne faut pas perdre de vue qu’un régime de transition militaire comme celui actuellement en place au Mali n’a rien de normal. Rien n’y est impossible. Et il y a toujours des manières pour exproprier quelqu’un sans dire qu’on l’exproprie. » « Nous sommes dans un pays où la loi est faite à la guise des colonels. Pourquoi ne pourraient-ils pas décider de retirer un permis minier ? » s’interroge un homme d’affaires malien.
Certains ont aussi en mémoire le précédent de la mine d’or de Ndassima, l’une des plus importantes de Centrafrique. Initialement accordé à l’entreprise canadienne Axmin, son permis d’exploitation a finalement été réattribué par les autorités centrafricaines à Midas Ressources – une société liée à la galaxie Prigojine – fin 2019, environ deux ans après l’implantation de Wagner à Bangui.
Grande refonte du secteur minier
Sans forcément parvenir à récupérer les permis d’exploitation des mines qu’il lorgne, Wagner pourrait aussi capter, par des voies détournées, une partie de la participation de 10 % à 20 % que l’État détient dans chacune d’entre elles. « Quand nous donnons chaque année sa part au Trésor public malien, nous ne savons pas comment il réutilise cet argent derrière », glisse le collaborateur d’une grande entreprise minière.
Lancement d’un grand audit du secteur minier, création d’une Société de recherche exploitation minière (Sorem) pour accroître les bénéfices de l’État, suspension des permis d’exploration et d’exploitation pour « améliorer le processus de délivrance et de suivi des autorisations »… Fin 2022, la junte a amorcé une grande refonte du secteur minier. Mais, malgré le forcing de leurs nouveaux alliés russes, les colonels ne semblent pas pressés de leur ouvrir grand les portes des mines, preuve que leurs relations sont plus complexes qu’il n’y paraît.
« Ils veulent cantonner Wagner au domaine militaire et ce pour quoi ses mercenaires ont été embauchés : la guerre contre les jihadistes. Dès que les Russes essaient d’avancer sur le dossier des mines, ils freinent. Et il faut bien leur reconnaître un certain talent pour faire traîner les choses », indique un observateur à Bamako. « Les colonels souhaitent montrer qu’ils restent souverains chez eux et ne veulent pas que les Russes deviennent visibles partout comme ils le sont en Centrafrique. Cela est valable pour l’administration comme pour les mines », ajoute un diplomate étranger.
Actifs dans l’orpaillage artisanal
En attendant de parvenir à mettre en place un système d’extraction bien rodé au Mali, les cadres de Wagner exploitent toutes les pistes possibles pour extraire de l’or. Le 30 septembre 2022, Gold Resources du Mali, une des sociétés de Bakin Gassimi Guindo, a obtenu du ministère deux permis d’autorisation d’exploration de trois mois à Diangouémérila-Ouest (sur une superficie de 40 km2) et Ourou-Ourou (sur 22 km2), dans le district de Yanfolila. Le fondateur d’Alpha Development y a-t-il mené des prospections pour le compte de ses partenaires russes ? Là encore, l’intéressé n’a pas souhaité répondre.
Parallèlement, Laktionov et ses camarades se sont lancés dans l’orpaillage artisanal, qui représente, selon les estimations, environ un tiers de la production nationale, soit plus d’une vingtaine de tonnes d’or par an. Selon nos informations, depuis le début de l’année, des hommes de Wagner ont investi au moins trois sites au sud de Bamako, dont certains étaient jusqu’à leur arrivée exploités par des Chinois.
L’un d’entre eux se trouve à Balandougou, à une vingtaine de kilomètres de la frontière avec la Guinée. « Ils sont venus avec leurs machines. Ils étaient nombreux et ont travaillé avec des locaux. Ils sont restés quelques semaines puis ils sont repartis », confirme un témoin sur place. Selon lui, ces exploitants « qui ne parlaient pas français » ont ensuite mis le cap sur Koyoko, un autre lieu d’orpaillage proche de la frontière, situé dans le cercle de Kangaba. Le troisième site est, lui, situé près de Yanfolila.
Difficile, voire impossible de savoir quelle quantité d’or a été extraite de ces sites d’orpaillage artisanaux par les hommes de Wagner. Mi-mai, une dizaine d’entre eux ont par ailleurs été aperçus à l’aéroport de Kayes, chef-lieu de la région du même nom, réputée riche en or et éloignée de leurs zones d’activités militaires classiques du Nord et du Centre.
Trafic via Dubaï
En 2022, les responsables du groupe russe se sont également rapprochés d’un des nombreux négociants en or bamakois pour faire fructifier leurs affaires : Kossa Dansoko. Présent dans le secteur depuis une décennie, il achète, exporte et revend de l’or à Dubaï. Ces dernières années, la riche cité des Émirats arabes unis est devenue la destination privilégiée du trafic illégal d’or en provenance du continent. Les lingots – non raffinés à 100 % – issus des mines d’Afrique de l’Ouest transitent très souvent par le Mali en raison de sa fiscalité avantageuse sur l’export et de son important réseau de corruption.
Ainsi, comme le relevait une récente synthèse de l’Institut d’études de sécurité (ISS), en 2016, les Émirats déclaraient avoir importé 1,52 milliard de dollars d’or malien, tandis que le Mali n’enregistrait que… 216 millions de dollars d’exportations d’or vers ce pays. « Il y a tout un système de trafic mis en place à l’aéroport de Bamako, avec la complicité de la douane et de la police. Cela permet aux négociants de passer les contrôles sans encombre et de s’envoler pour les Émirats avec plusieurs kilos d’or dans leurs valises », explique un bon connaisseur.
« Dansoko vend son or à Dubaï et il récupère du cash, qu’il place sur des comptes offshore là-bas ou qu’il ramène à Bamako pour le changer directement auprès de grands commerçants plutôt que dans des banques », ajoute une de nos sources. Souvent à Dubaï, Kossa Dansoko se rend aussi régulièrement à Bangui, où il travaille avec Wagner via son compatriote Souleymane Bassoum. Bien implanté dans la capitale centrafricaine, proche du pouvoir du président Faustin-Archange Touadéra, ce Malien actif dans l’import-export participe au trafic local de diamants monté par le groupe de Prigojine.
Intriguant ballet aérien à Sikasso
Wagner achemine donc son or d’Afrique vers les Émirats arabes unis, mais aussi directement en Russie. Pour sortir cette marchandise de valeur du continent à l’abri des regards, la société militaire privée utilise différentes filières, dont ses propres moyens aériens – hélicoptères Mil, petits porteurs Antonov, gros porteurs Iliouchine…
Pour ses activités au Mali, elle s’appuie sur une société d’aviation fondée en 2008 aux Émirats : Kratol Aviation, qui dispose d’une petite flotte d’Antonov An-28, des avions robustes pouvant se poser à peu près n’importe où. Épinglée en janvier par le département du Trésor des États-Unis comme l’une des entités « qui soutiennent les opérations militaires du groupe Wagner » en Afrique, cette société est, selon une source proche des services de renseignement français, « au cœur d’un réseau de logistique aérienne servant les intérêts russes, notamment miniers, sur le continent ».
En juillet 2022, un de ses An-28 avait été photographié par un satellite sur le tarmac de l’aéroport de Mopti-Sévaré, un des hubs logistiques de Wagner dans le pays. Cet avion d’apparence civile, complètement blanc, était immatriculé TZ-99T, un code de l’armée de l’air malienne.
Un autre aéroport malien, moins connu, est utilisé par Wagner : celui de Sikasso, à 400 km au sud-est de Bamako. Plus de connexion permanente avec l’Asecna, plus de compagnie commerciale… Il offre des avantages certains à qui souhaite y atterrir et en décoller discrètement. Entre fin 2022 et début 2023, plusieurs avions russes se sont posés sur sa piste décatie, de nuit, pour décharger et charger des marchandises. « Ils transportaient très probablement du matériel militaire. Mais il ne serait pas surprenant que de l’or transite aussi par cette voie », conclut une de nos sources maliennes.