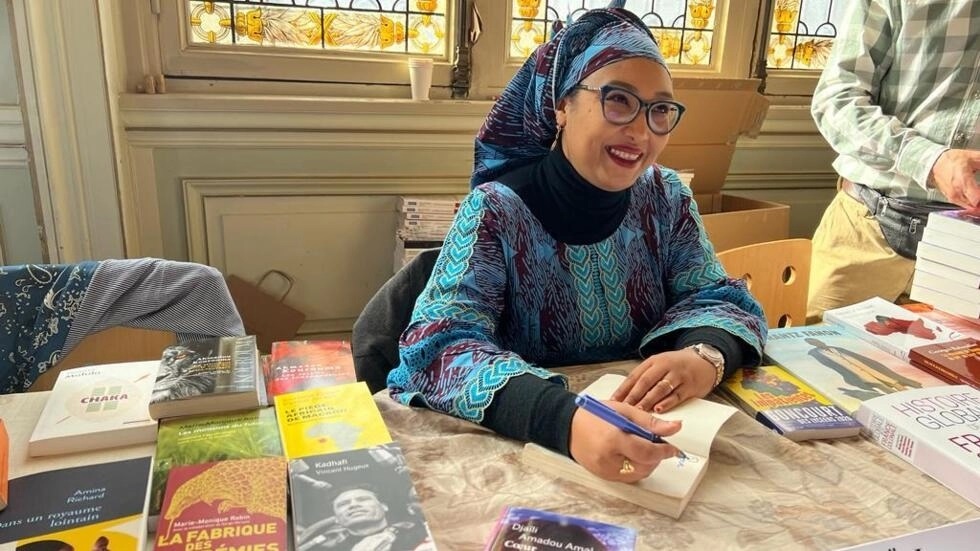Détenu depuis près de quatorze ans pour atteinte à la sureté de l’État, Kpatcha Gnassingbé a été évacué vers le Gabon pour des raisons sanitaires. Il s’est envolé le 23 mars à bord d’un vol spécial à destination de Libreville, selon RFI. Âgé de 52 ans, éprouvé par sa longue détention, il devrait y subir une intervention médicale.
Depuis plusieurs années, ses avocats et des associations de défense des droits de l’homme alertaient sur la dégradation de son état de santé et réclamaient sa libération. Ils s’appuyaient notamment sur un avis rendu en décembre 2014 par le Groupe de travail sur la détention arbitraire, organe dépendant du Conseil des droits de l’homme des Nations unies, lequel considérait comme arbitraire la détention de Kpatcha Gnassingbé et de plusieurs de ses coaccusés.
En juillet 2013, la Cour de justice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) avait déjà qualifié le procès d’inéquitable en raison d’actes de torture perpétrés contre les prévenus. L’État togolais avait été condamné à dédommager financièrement ces derniers, sans que cela ne soit suivi d’effets.
Problèmes de santé
Kpatcha Gnassingbé avait en parallèle demandé une conciliation avec Faure Essozimna Gnassingbé, laquelle avait été confiée au chef de canton de Pya, le village natal de la famille Gnassingbé, situé à 430 km au nord de Lomé. Il avait également introduit une demande de grâce présidentielle, mais sans plus de succès. Ces derniers mois, alors que son état de santé s’était de nouveau dégradé, il avait été transféré au pavillon militaire du Centre hospitalier universitaire Sylvanus-Olympio, à Lomé. Il y avait déjà été hospitalisé en 2015, victime, selon certaines informations, d’une embolie pulmonaire résultant des complications d’un diabète et d’une hypertension artérielle.
Frère cadet du président, Kpatcha Gnassingbé était considéré lors du décès de leur père, Gnassingbé Eyadéma, comme le chef de file de la tendance dure du Rassemblement du peuple togolais (RPT, au pouvoir), en opposition à la ligne réformiste incarnée par Faure Gnassingbé.
C’est en juin 2005 que ce dernier, tout juste élu, lui confie le poste de ministre de la Défense. Pendant deux ans, la cohabitation entre les deux frères se déroule sans heurts particuliers. « Je l’ai nommé parce qu’il est compétent et parce que l’armée togolaise ne lui est pas inconnue, confiait le chef de l’État à Jeune Afrique en janvier 2007. Cela se passe bien. »
Amertume
Onze mois plus tard, Kpatcha était limogé sans explications officielles. En réalité, cet ancien élève du lycée militaire de Kara, titulaire d’un Bachelor of Science obtenu en Grande-Bretagne et que son père a toujours étroitement associé à l’armée, cachait de moins en moins son amertume de ne pas avoir été choisi pour lui succéder.
Sanguin, impulsif, il ronge son frein avant d’être arrêté le 12 avril 2009 par les forces spéciales après avoir résisté, les armes à la main, puis tenté en vain de se réfugier à l’ambassade des États-Unis. Incarcéré, il est condamné en septembre à vingt ans de prison par la Cour suprême du Togo pour avoir, en compagnie de complices – dont le général Assani Tidjani, ancien chef d’état-major –, tenté de renverser le pouvoir en place.
De cette affaire douloureuse, Faure Gnassingbé n’a toujours parlé que par bribes, avec pudeur et réticence. En avril 2015, il s’en était ouvert à François Soudan, directeur de la rédaction de Jeune Afrique, lors d’un entretien à bâtons rompus pour faire part du dilemme qui était le sien. Fallait-il, au nom de la famille, gracier un homme qui, six ans après les faits et après avoir reconnu son implication dans une tentative de coup d’État, ne manifestait alors aucune repentance ? Ne risquait-il pas de récidiver une fois élargi ?
Prudence
Détenu dans des conditions proches d’une résidence surveillée – il pouvait recevoir des visites, communiquer avec l’extérieur et vivre avec son épouse –, Kpatcha entretenait en outre de discrètes relations avec l’opposition togolaise.
Après plus de treize années de ce traitement, il est probable que les velléités et les appétits de l’ancien ministre de la Défense se soient émoussées. Mais c’est au Gabon, où Faure Gnassingbé pourra mieux s’assurer de la discrétion de son frère qu’en Europe, qu’il a envoyé celui-ci se faire soigner.