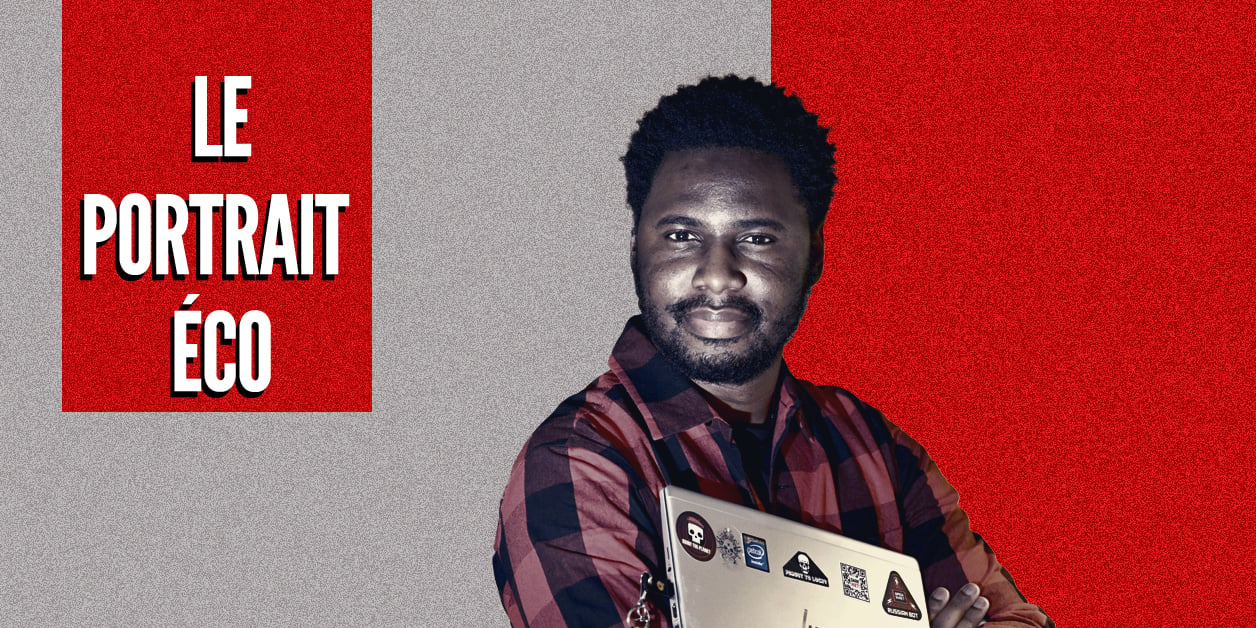La 15e édition du Festival des musiques urbaines d’Anoumabo (Femua) s’est déroulé du mardi 25 avril au dimanche 30 avril 2023. © Facebook de FEMUA
Samedi matin, prêt à lancer les balances pour les prestations du soir, Éric est sur les pelouses de l’Institut national de la jeunesse et des sports (INJS), au sud d’Abidjan, transformé en salle de concert à ciel ouvert. Comptable de profession, ce quinquagénaire a rejoint l’organisation du Festival des musiques urbaines d’Anoumabo (Femua) à l’invitation de Salif Traoré, alias A’Salfo.
« À l’époque, en 2015, les Magic System avaient un restaurant-bar, le Live Set à Cocody avec des soirées zouglou tous les jeudis, raconte-t-il. J’y ai été présenté à Salif, le leader du groupe. Il m’a dit : “Je vois ce que tu fais pour le zouglou, continue et ça va payer un jour.” » Fondateur du groupe Facebook Génération Zouglou, Éric est un passionné de ce genre musical phare depuis les années 1990. Quelques mois plus tard, Salif le contacte « pour suivre une formation ». « La semaine suivante, je suis auprès de promoteurs de festivals venus de France, du Maroc, etc. », se souvient-il.
Rumba, Zouglou, rap
Pour cette 15e édition du Femua, Éric pilote la scène « village » dédiée aux artistes locaux et émergents. Après une spéciale rumba en ouverture mardi, une dédiée au zouglou jeudi, ce soir place au rap. À quelques mètres, sous une tonnelle dédiée à la restauration, en bord de lagune, Manadja, l’un des quatre « magiciens » – « l’œil d’A’Salfo quand il n’est pas là », comme le décrit un proche – retrouve une partie des équipes. Il y a Pascal qui vient chaque année, depuis Paris, filer un coup de main bénévolement « par amitié » pour le groupe. Il sort alors sa carte de membre de l’équipe du Femua. Un sésame symbolique qui reconnaît l’appartenance à une bande dont les liens sont avant tout humains.
Il y a aussi Basse, du fan club des Magic System, et non loin de là Ismo, ami d’enfance et membre de la commission transports. « A’Salfo est un leader depuis toujours. Il organisait déjà, quand il était enfant, des tournois de foot. » D’anecdote en anecdote, Ismo évoque la famille d’A’Salfo : du frère jumeau installé en France, à Harouna, le cadet, aujourd’hui commissaire des moyens généraux du festival, qui a toujours soutenu A’Salfo. « Quand Salif était privé de repas pour avoir fait de la musique, Harouna lui apportait à manger en cachette », dit-on.
A’SALFO A UNE VRAIE VISION. C’EST AUSSI QUELQU’UN DE LOYAL, QUI PLACE UNE GRANDE CONFIANCE DANS SES ÉQUIPES
Il se souvient aussi d’une mère qui était une « véritable figure » à Anoumabo, où lui et les quatre magiciens ont grandi. « Elle est partie avant de voir tout ce qui a été accompli », se désole-t-il. Le père, de la Côte d’Ivoire à son Burkina Faso originel, a lui pu admirer le parcours du quatuor. À la question « n’est-ce pas un défi d’accueillir autant de stars, à l’instar de Booba ? », il répond spontanément : « On a l’habitude, on a déjà les Magic System ! »
Femua kids
Manadja se souvient des premières scènes, quand ils étaient tête d’affiche et organisaient le Femua sur fonds propres. « Dès le départ, il s’agissait de faire quelque chose pour les enfants. » Depuis, la Fondation Magic System a financé la création d’écoles à Anoumabo et dans le reste du pays. « Mon coup de cœur, c’est le Femua Kids », poursuit Manadja, né dans ce village ébrié de Marcory et issu d’une famille malinké du Nord. « C’est quelque chose de voir ce parc d’attractions que l’on installe pour les gosses. » Près de 1 000 jeunes ont investi l’INJS mercredi, venus de plusieurs orphelinats de la ville.
Alors que se clôture dans quelques heures la partie abidjanaise du Femua, le déjeuner se déroule dans une ambiance détendue. Les anecdotes fusent, évoquant une prestation récente des Magic System à Dubaï, et certains souvenirs des manifestations étudiantes à Abidjan. Hélène, la femme d’A’Salfo, qui coordonne le restaurant éphémère, rejoint la tablée. Le débat s’ouvre sur l’idée d’inviter les Antilles à une prochaine édition. Cette année c’était le Togo qui était à l’honneur.
Il est 15 heures, Manadja se dirige vers la grande scène. Il retrouve Ronan, le coordinateur général. Passé par l’organisation des festivals Rock en seine et Paris plage, il rejoint le Femua, chaque année depuis 2016, à l’invitation du leader des Magic System. « A’Salfo a une vraie vision. C’est aussi quelqu’un de loyal, qui place une grande confiance dans ses équipes. »
En cercle, à l’ombre d’un soleil tapant, il y a aussi Harouna, Éric, et Loter. Ce dernier est une autre figure légendaire du Femua. Le régisseur général a sonorisé les concerts des PBS, de Youssou N’Dour ou d’Alpha Blondy. S’ils se réunissent en cette fin d’après-midi, c’est pour évoquer la sécurité du concert : 200 policiers, 300 gendarmes et 80 personnes ont été mobilisés. Tous ont en mémoire les mouvements de foule du concert de Kaaris en 2019.
« La rigueur, le secret du Femua »
16 heures, l’équipe de Booba arrive pour les balances. Elle fait le tour du site et fait le point sur le catering : du champagne, du whisky, des fruits, mais pas de chicha. C’est interdit dans les loges en toile cirée. Question de sécurité. « La rigueur, c’est ça le secret du Femua », témoigne, casquette de Fela Kuti sur la tête, celui qui est en charge de la sécurité des Magic System. « Tu peux rigoler avant et après, mais pendant c’est carré. Sinon, tu dégages et quelqu’un d’autre va faire le taf à ta place. » Manadja confirme : « A’Salfo est très minutieux. Cela encourage les équipes à être sérieuses et investies. » Le responsable de la sécurité personnelle de Booba est confiant : « On sait déjà qu’on va kiffer, on est chez nous. »
18 heures, la scène rap ivoire se lance et accueille des artistes comme Dre-A et Defty, après une prestation remarquée de Didi B la veille. Les stands dédiés à la sécurité alimentaire, thématique phare de cette édition, se replient. A’Salfo vient d’entrer sur le site après une escale parisienne de vingt-quatre heures pour soutenir une thèse sur les droits d’auteurs. À peine arrivé, l’entrepreneur et artiste enchaîne les interviews. « C’est la force du festival », confie le manager de Roseline Layo, chanteuse de coupé-décalé qui se produit le soir même. « C’est un des événements où l’on peut avoir accès à des médias internationaux. »
21 heures, les « On veut Booba ! » sont déjà scandés par la foule. Depuis les loges, Santrinos Raphaël, premier artiste à se produire, se prépare. Tout de blanc vêtu, le jeune togolais se plie à l’obligatoire visite médicale. « C’est déjà arrivé qu’en raison d’une tension trop élevée, nous refusions à une artiste de monter sur scène », insiste Marie-Pascale, membre de l’équipe du Femua. Loter rassure les artistes : « Ne vous mettez pas la pression, restez vous-mêmes », tandis que leur manager répète : « On sourit et on y va. » C’est parti pour six heures de concerts gratuits. Lili, qui assure la tenue des loges, est sereine : « Ça va être la course, mais on a l’habitude. » A’Salfo est dans l’espace VIP pour accueillir les partenaires. « Quatre ministres ont confirmé leur présence », précise Manadja.
« Un conseil du gouvernement à Anoumabo »
Si le Femua est soutenu depuis des années par des acteurs privés et publics, il aura franchi une nouvelle étape pour cette édition. « A’Salfo et ses camarades ont réussi à faire un conseil du gouvernement ici, à Anoumabo », a ainsi lancé le maire de Marcory, lors de l’ouverture du festival, mentionnant, en plus du parterre de ministres, la présence de la fille de Laurent Gbagbo, de Charles Blé Goudé et de la femme du Premier ministre. « C’est cela la réconciliation, c’est cela la cohésion nationale » a-t-il poursuivi. « Jamais on n’a eu les différents partis politiques dans un même lieu. A’Salfo est politique sans l’être. Il fait comprendre que la culture est un vecteur de rapprochement et d’unité », constate Serge Fattoh, qui présente les concerts du Femua pour la 14e fois.
AVEC LES ARTISTES DU FESTIVAL, NOUS ESPÉRONS MONTRER À TOUS QU’AVEC LA CULTURE, NOUS AVONS LE CANAL LE PLUS SÛR POUR DÉVELOPPER UN PAYS
Un compagnonnage qui remonte à la première cassette des Magic System, Premier Gaou. Mais loyauté n’est pas complaisance : « Il y a du monde dans l’organisation du Femua, mais tout est structuré. Si ça tourne, ça ne vient pas du hasard. Ceux qui ont failli sont partis. Les autres continuent la route. » Une route qui a eu son lot d’épreuves. Deux dates reviennent en mémoire : la crise politique pendant laquelle le festival, même s’il a été décalé, a été maintenu. Et la mort de Papa Wemba sur scène en avril 2016. Éric se souvient : « Cette épreuve nous a montré la grandeur d’esprit et la force de Salif. Il était abattu, mais il a traversé ce drame et fait en sorte que le festival aussi. »
22 h 15, Roseline Layo monte sur scène face à un public qui entonne ses tubes. Fier, un des membres de son équipe témoigne : « Je viens au Femua depuis la première édition. Depuis Cocody, on s’organisait pour venir dormir sur place. C’est un festival humain. C’est pour ça qu’on est fidèle aux Magic System. » L’excitation de la foule à l’approche du concert de Booba s’intensifie. A’Salfo prend la parole : « Je préviens le danger. Est-ce que vous voulez qu’on fasse décoller Booba de son hôtel ? » La pression retombe quelque peu pendant la prestation du rappeur gospel KS Bloom.
Un public conquis
00 h 30, Booba arrive en arrière-scène, pantalon treillis, casquette et sourire aux lèvres. Manadja rappelle que la rencontre avec le rappeur date des débuts des Magic System. « Les artistes viennent par amitié pour ce festival fondé par des artistes. Ils comprennent aussi l’enjeu social. » Quand Booba entre en scène, la foule exulte, déborde, et les barrières de sécurités sont difficilement maintenues par un cordon de gros bras. Deux coupures de courant font craindre l’émeute. En backstage, dans un calme olympien, s’enchaînent réunion de crise et mobilisation de l’équipe technique. Après un nouvel appel au calme d’A’Salfo, Booba ira au bout de son set devant un public conquis.
2 h 45, le rappeur quitte la scène, sourire exponentiel. Dans les loges, les mines concentrées laissent place aux rires. A’Salfo débarque : « Organiser un Femua tout en faisant une thèse, et réussir les deux, c’est dangereux ! », plaisante l’artiste, qui avait repris ses études en 2021. « Notre motivation ? On a toujours envie de faire mieux », continue Manadja. « Pour ceux qui veulent se lancer dans l’événementiel, le Femua est le lieu pour apprendre. C’est un festival de musique d’ampleur et une grande école », témoigne Serge Fattoh. Cette année, plusieurs membres d’un festival du nord du pays sont d’ailleurs en stage. En attendant la 16e édition, le zouglou de Samy Success et la rumba de Ferré Gola maintiennent attentif un public qui s’est un peu dispersé.
Dans quelques heures, direction Bouaké pour la partie délocalisée du Femua. Baaba Maal, Roseline Layo, Safarel Obiang, Singuila et Ferré Gola feront danser plus de 20 000 personnes. À chaque étape, A’Salfo répète : « Avec les artistes du festival, nous espérons montrer à tous qu’avec la culture, nous avons le canal le plus sûr pour développer un pays. »