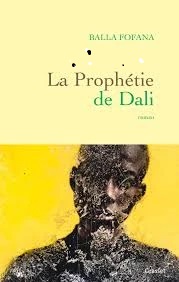Balla Fofana© J.F. Paga/Éditions Grasset Balla Fofana © J.F. Paga/Éditions Grasset
« Je vais commettre un braquage. » Dès l’incipit de son premier roman, La Prophétie de Dali, Balla Fofana nous captive. Il se plonge dans la peau de son double littéraire, Balla, enfant de six ans, qui commet un acte lourd de conséquences : à la cantine de son école de Saint-Maur-des-Fossés (France), il saisit des haricots verts avec les doigts avant de les manger. Ce geste, naturel dans son village de la région de Kayes au Mali, Sakora, lui vaut d’être placé en « classe de perfectionnement ». Selon un arrêté de 1964, ces classes étaient destinées jusqu’en 2005 « à recevoir des enfants accusant un déficit intellectuel ».
L’oracle de la griotte
Voilà le destin auquel était promis le garçon mutique qui se raccroche à la prophétie de Dali, une griotte, dont il se délecte des histoires : « Balla deviendra quelqu’un ! » promet-elle à sa mère. Contre le déterminisme social, contre les voix qui le condamnent à l’échec, contre l’absence de son père, le jeune homme se construit, d’abord grâce à sa mère. Wassa Magassa, qu’il appelle Na, n’a pas hésité à braver les réprobations de son clan pour partir seule en France. Elle veut offrir à ses six enfants la chance qu’elle n’a pas eu, celle d’aller à l’école, tout en maintenant le lien avec la culture mandingue : le kagoro est ainsi la seule langue parlée chez eux.
Le Cyclope, un psychologue attentif, Gérald, un camarade turbulent, Didier, un instituteur : tous font partie des figures touchantes qui, chacune à leur façon, croient en ce jeune homme. « On peut toujours faire quelque chose de ce qu’on a fait de nous », la citation de Jean-Paul Sartre pourrait résumer l’esprit de ce roman. Journaliste à Libération, ancien élève en classe de perfectionnement, Fofana a réussi son coup : il a braqué la littérature à la perfection et, comme il se l’était promis, il a vengé sa mère.
Jeune Afrique : Le protagoniste de votre roman se prénomme Balla. La Prophétie de Dali est-il un roman autobiographique ?
Balla Fofana : C’est une autofiction. Se mettre dans la tête d’un enfant de six ans relève forcément de l’invention. L’autobiographie pure ne m’aurait pas permis de me libérer comme je le voulais. Mon but était de créer un univers vraisemblable, enfantin et parfois drôle.
Balla parle des travailleurs masculins autour de lui comme des « tontons Charlot » en référence aux gestes mécaniques de Charlie Chaplin dans Les Temps modernes et des travailleuses féminines comme les « tanties Atlas », tel le titan de la mythologie grecque qui portait la voûte céleste sur ses épaules. Les uns construisent la France, les autres la nettoient. Parler d’eux, est-ce une façon de leur décerner la médaille dont le jeune conteur constate qu’ils sont dépourvus ?
Avec sa perspective d’enfant de 6 ans, Balla voit le monde d’une certaine façon, avec un vocabulaire propre. Toutes les personnes qu’il évoque sont des gens en marge qui vont être mis au centre. Personne ne donne de crédit à ces invisibles, qui sont littéralement la France qui se lève tôt et qui se couche très tard. Ils font ce qu’on appelle « le sale boulot » et dès que, par exemple, il y a une grève des éboueurs ou des gouvernantes à l’hôtel Ibis, on voit l’importance de ce qu’ils font.
LE SILENCE DE BALLA, PERÇU COMME DE LA PASSIVITÉ, EST SA MANIÈRE DE REFUSER CE QUI S’OFFRE À LUI ET D’AGIR
Balla est incompris et moqué parce que, élève d’une classe de perfectionnement, il est vu comme un « arriéré ». Sa singularité le condamne-t-il à la solitude ?
Balla est un enfant à l’intersection de toutes les marges. Il est enfant dans un monde d’adultes. Il est français mais lui-même, vivant un exil, doute de sa francité. Il est isolé à l’école. Cet isolement le met à part dans sa fratrie, et il finit par se persuader qu’il est idiot alors que le système de narration montre, au contraire, qu’il est érudit. À travers ce décalage, je pose la question du regard qu’on pose sur l’autre. En fonction de ses interlocuteurs, soit il est vu comme riche de potentiel ou tout l’inverse. Son silence, perçu comme de la passivité, est sa manière de refuser ce qui s’offre à lui et d’agir.
La prophétie de Dali, qui donne le titre à votre roman, est-elle un contrepoint à la somme de malédictions qui pèsent sur Balla ?
Il y a en effet la malédiction des personnes de son village qui vont prendre à partie sa famille, la malédiction d’Arasa Fàtɔ, le rasta fou, qui lui promet que ses nuits seront hantées par son père, la malédiction du regard posé sur lui. Vient en plus s’ajouter la malédiction sociale.
Il n’est ni assez malien ni assez français aux yeux des autres et, en plus, il doit gravir les échelons en supportant des injonctions sociales contradictoires sur l’universalisme, la représentation des minorités et les clichés autour d’elles. Dali, la griotte qui lui prédit un brillant avenir, le met en garde contre la production de statistiques, non en tant qu’instrument scientifique nécessaire de mesure de la réalité, mais comme pouvant conduire à un certain fatalisme.
À propos de catégorisation, Dali dit à Balla : « Si tu rentres au Mali en disant que tu es un Noir de France, tout le monde rira. Car cette définition étriquée de toi-même portera les preuves irréfutables de ton aliénation. » Se dire « Noir de France » est un enfermement ?
C’est un enfermement parce que ça a été défini par d’autres. L’Occident s’est beaucoup construit en opposition et a créé une ligne de couleur entre le blanc et le noir, et toutes les teintes intermédiaires. Contrairement aux Américains et aux Caribéens, les Africains de la métropole française n’ont ni été déportés ni réduits à l’esclavage.
AFFIRMER QUE LES RACES N’EXISTENT PAS, ET QUE NOUS NE SOMMES QU’UNIVERSELS, EST UN DÉNI DE LA RÉALITÉ DES DYSFONCTIONNEMENTS STRUCTURELS EN FRANCE
Les habitants de leur pays d’origine ne se définissent pas par leur couleur de peau. Ils peuvent dire qu’un individu est clair ou foncé de peau mais ce n’est pas ce qui est déterminant dans leur identité. La réflexion de Dali revient à lui conseiller de sortir de l’enfermement quand on se sent parfois bloqué dans un système.
Récusez-vous le mot « race » ?
Socialement les races existent et, en France, les individus sont réduits à des stéréotypes raciaux dans un pays qui en même temps se fait le chantre de l’universalisme, et qui prétend ne pas reconnaître les races. C’est cette contradiction doublée d’hypocrisie qui rend fou. On n’a jamais réussi à faire entrer l’Autre minorisé – autrement dit, victime d’un système de domination – dans l’universalité en France. C’est cet échec qui fait qu’on est dans une société racialisée. Affirmer que les races n’existent pas et que nous ne sommes qu’universels est un déni de la réalité des dysfonctionnements structurels dans ce pays.
Je vous cite : « Les personnes conscientes de leur valeur m’attirent […]. Quand on vous fait comprendre que vous n’êtes rien. Que vous ne serez rien. Que vous n’êtes pas français à part entière, mais français entièrement à part. Il y a une qualité qui vous donne une énergie folle pour tromper la misère : l’arrogance. » En quoi l’arrogance aide-t-elle Balla à dépasser la misère ?
Gérald, le camarade de classe de Balla en perfectionnement, l’initie à l’arrogance. Ce n’est pas le sentiment de supériorité du puissant face à quelqu’un de plus faible, mais un élan qui permet de ne pas se contenter de ce qu’on nous donne ni de la vision qu’on a de nous. Elle vient casser les statistiques. Cette arrogance est saine, elle permet de dépasser les prophéties de malheur pour aspirer à être soi.
Encore une citation : « J’écris pour venger Na » (sa mère). La Prophétie de Dali est-il l’instrument de cette vengeance ?
Je suis issu d’une génération qui n’a pas toujours compris pourquoi nos parents sacralisaient l’école. C’est dur pour des enfants de porter aux nues ce qui est accessible à tout le monde, et obligatoire jusqu’à 16 ans. Le fait de pouvoir être scolarisé est tellement naturel qu’on oublie que c’est fondamental. Pour ma mère, avoir été empêchée d’aller à l’école a été une grande frustration et une blessure. La France est un pays qui estime que son génie repose dans les livres, et s’instruire, écrire un roman, raconter l’histoire de Wassa Magassa, c’est la venger de la plus belle des manières, par la littérature.
L’IDÉE D’ÉCRIRE ME VIENT QUAND MON PROFESSEUR, DIDIER, M’IMPOSE L’ÉCRITURE. J’ÉCRIS UNE FABLE QUI L’ÉMEUT JUSQU’AUX LARMES
Pourquoi l’apprentissage du kagoro est-il un enjeu fondamental pour Wassa ?
C’est un enjeu qui renvoie à l’identité et à la culture. Ce va-et-vient entre les langues dans la narration incarne la tension pour les faire coexister. Une langue est une vision du réel, et quand on superpose plusieurs langues, on superpose plusieurs visions. La décision de se battre pour maintenir sa langue d’origine, qui est vue comme inférieure ou non-stratégique en France, c’est un vrai combat politique.
Wassa le fait de manière basique en disant que ce serait la fin du monde si ses enfants étaient incapables de parler à sa mère. Cela va à l’encontre du projet assimilationniste français selon lequel il fallait supprimer toutes les autres identités pour embrasser pleinement l’identité française. C’est une femme qui entre en résistance contre l’injonction à parler français pour que ses enfants réussissent à l’école. Ce qu’elle veut, elle, c’est l’excellence dans les deux langues.
Vous écrivez : « Je ne sais pas si le métier existe mais quand je serai grand, je veux être liseur. » Auriez-vous imaginé devenir « écriveur » ?
Ce n’est pas un projet que j’ai formé, et encore moins dans l’enfance. J’étais un conteur qui s’ignorait ou qui ne montrait pas ses talents à tout le monde, seulement à quelques personnes, à la marge. L’idée d’écrire me vient quand mon professeur, Didier, m’impose l’écriture. J’écris une fable qui l’émeut jusqu’aux larmes et cela me fait littéralement sortir de la classe de perfectionnement.
Qu’est-ce qui vous a conduit d’abord au journalisme ?
Ma faculté d’intégration du français m’a permis de réaliser que j’apprenais facilement les langues, j’ai donc passé un bac littéraire avec trois langues : l’anglais, l’espagnol et l’italien. J’ai enchaîné par une licence LEA (langues étrangères appliquées) puis un master en communication politique, dont je suis sorti major. Mais pour faire carrière dans cette voie, il faut être encarté ou avoir un carnet de contacts conséquent.
En 2013, mon dernier stage a eu lieu à la Fondation groupe France télévisions, où je gérais les bourses. Dans le jury, il y avait Djamel Hamidi, le frère de Mohamed Hamidi du Bondy Blog, qui m’a invité à déjeuner. Il m’a demandé si j’écrivais, il m’a parlé du média en ligne… Nous avons passé la journée à discuter. C’était un mardi, jour de la conférence de rédaction. J’y ai assisté et tout a commencé pour moi. En me publiant, le Bondy Blog m’a confronté à d’autres regards que celui de mes professeurs et de mes connaissances.
Comment vous est venue l’idée d’écrire La Prophétie de Dali ?
Un événement a changé le cours de ma trajectoire en 2015. Pour la commémoration des 10 ans de Zyed Benna et Bouna Traoré, un numéro de Libération est intégralement écrit par le Bondy Blog. J’ai rédigé « J’ai le syndrome du survivant », un papier qui reprend en filigrane le contenu de ce roman. Il a énormément circulé, j’ai reçu un retour de Najat Vallaud-Belkacem – à l’époque ministre de l’Éducation nationale –, il a été partagé sur les réseaux sociaux par l’ancienne ministre de l’Égalité des territoires et du Logement Cécile Duflot…
J’ai reçu des premières propositions d’éditeurs mais en 2015, je n’avais pas de situation professionnelle stable et je ne voulais pas fonder tous mes espoirs sur ce livre pour m’en sortir. J’ai répondu que je n’étais pas prêt, même si c’était dur de refuser des propositions d’avances alléchantes. J’ai commencé à écrire le brouillon du livre pendant le confinement, une période propice à l’introspection.
D’où vous vient ce style truculent ?
Je suis le fruit de la tradition orale et de la tradition littéraire, qui est une parole couchée sur papier. Tout mon univers créatif baigne dans ces deux mondes et pour créer, je puise en eux sans faire de hiérarchie.
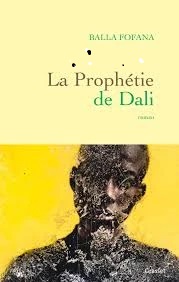
© Éditions Grasset
La Prophétie de Dali de Balla Fofana, Éd. Grasset, 216 p., 19,50 €


 mer. 19 juil. 10:45 (il y a 2 jours)
mer. 19 juil. 10:45 (il y a 2 jours)
 Père KIYE Mizumi Vincent
Père KIYE Mizumi Vincent